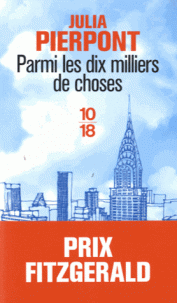L’armée de Sarrail s’est remise en mouvement
(De l’envoyé spécial du Petit Journal.)
Salonique,
29 mars.
Nos canons ont tonné sur les Bulgares et nos hommes ont
poussé une franche attaque dès le vendredi 16 mars. Malgré la pluie, dans
ces deux premiers jours, une centaine de prisonniers, dont un
lieutenant-colonel, furent ramenés.
Quinze cents mètres de tranchées furent enlevés.
L’attaque continue.
Dans deux mètres de neige et par 15 degrés de froid
Silencieuse, en effet, depuis la prise de Monastir, l’armée
d’Orient recommence à se mouvoir. Si tout cet hiver fut de mutisme, il ne fut
pas d’insomnie. Combien de fois, quand arrivait ici l’écho de cette question :
mais que fait donc l’armée d’Orient ? ceux d’ici durent-ils se retenir
pour ne pas dévoiler le secret des montagnes ?
Si les deux mètres de neige et les 15° de froid des crêtes
de Macédoine avaient pu parler, la France aurait appris ce que le général
Sarrail faisait dans les Balkans.
Des régions entières étaient nettoyées de comitadjis, des
cols étaient franchis, des troupes étaient envoyées à quatre-vingt-dix
kilomètres su chemin de fer, sans autres moyens que ceux dont disposait Annibal ;
l’armée d’Orient, pour ses actions futures, crânement allait se placer.
Aujourd’hui, aux endroits choisis par elle, elle se montre à
l’ennemi.
Les actions que les communiqués vous signalent entre les
lacs Prespa et Ochrida et au nord de Monastir sont les premiers symptômes de
son réveil.
Ce que sont les Bulgares
Donc l’armée d’Orient, pour la troisième fois, entre en
offensive. La première la conduisit près de Vélès, la seconde la porta dans
Monastir, et voilà la troisième, dont nous dirons plus tard ce qu’elle a donné.
Tout l’hiver elle a travaillé. Les officiers et les soldats n’avaient guère le
temps de voir les minarets de Salonique, car la campagne macédonienne les
appelait aussitôt à plus de deux cents kilomètres de la mer et ils allaient s’installer
dans les montagnes.
On préparait la marche de printemps.
La neige, le froid, les cols, les précipices, les
comitadjis, rien n’arrêta la réalisation du plan conçu. Pendant trois mois,
sans autre consigne que le silence, elle peina dans des pays presque
impénétrables. Des convois, sur 90 kilomètres, s’aventurèrent là où une
voiture n’avait jamais osé rouler. On porta la préparation jusqu’en Albanie.
Largement, l’avenir était envisagé.
Pendant ce temps, les Bulgares, suivant servilement les
leçons générales de la guerre moderne, se contentaient de se fortifier là où
ils nous voyaient en face.
Ne prêtant pas à leurs ennemis des imaginations qu’ils n’avaient
pas, ils ne se gardaient de ses coups qu’aux endroits où ils croyaient devoir
les encaisser. Sagement, ils s’occupèrent de consolider différentes portes d’entrée
de leur pays. Le malheur pour eux, c’est qu’ils ne pensèrent peut-être pas que
par les fenêtres aussi on peut pénétrer chez autrui.
J’ignore complètement de quelle façon le général Sarrail
tentera de s’introduire chez son voisin. Manœuvrier, il va manœuvrer.
Le plus sérieux de la valeur bulgare réside dans le nombre
et dans les cadres allemands. Or, dans la guerre stratégique, le nombre ne se
place plus au premier rang des avantages. Les mille prisonniers qu’en moins de
trois jours elle vient de faire prouvent que les tout premiers coups de l’attaque
montée les ont déjà fait vaciller.
Si les Bulgares avaient été seuls, sans pions allemands, ils
auraient sans doute, dès nos actions de l’automne dernier, plus largement lâché
prise.
Depuis, l’hiver a passé sur eux, les pions allemands n’ont
pas augmenté en proportion de leur désillusion et les régiments turcs qui
étouffaient leurs rangs ne sont pas loin de quitter le front de Macédoine pour
leur Asie chancelante.
Sans se gonfler de l’espoir qui, à ces premiers pas,
rajeunit tous les combattants d’Orient, je puis bien vous dire que jamais avec
plus de raisons la victoire n’est apparue à ceux qui se levaient pour la
prendre.
Monastir dégagée
La cote 1248 vient d’être enlevée. Monastir est
dégagée.
Avant-hier, les Bulgares avaient bombardé la ville avec des
obus asphyxiants. Nos ennemis se valent. Les Allemands brûlent Bapaume quand
ils la perdent, les Bulgares, eux, empoisonnent Monastir quand ils se voient
forcés de lui dire adieu.
Pendant quatre mois, la cité fut sous leurs canons.
Mme Harley, sœur du général French, aura été une de leurs dernières
victimes.
Les premières journées de l’attaque par l’armée d’Orient
sont heureuses, les résultats prévus se réalisent.
Si nous n’avons pas encore de noms retentissants à vous
jeter dans les communiqués, c’est que les grandes villes ne poussent pas à
toutes les descentes de crêtes, en Macédoine, c’est que c’est un peu dans le
bled que l’on se bat ici.
Nos troupes auront à avaler pas mal de kilomètres de
campagne avant de trouver au bout de leurs baïonnettes un nom qui fasse écho.
Les soldats de Mésopotamie, dans de semblables conditions,
finirent bien un jour par crier : « Bagdad ! » Les soldats
de Macédoine, maintenant qu’ils sont partis, finiront bien aussi par pousser
leur cri.
Le Petit Journal, 30 mars 1917.
La Bibliothèque malgache publie une collection numérique, Bibliothèque 1914-1918, dans laquelle Albert Londres aura sa place, le moment venu.
Isabelle Rimbaud y a déjà la sienne, avec Dans les remous de la bataille, le récit des deux premiers mois de la guerre.
Et Georges Ohnet, avec son Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, dont le dix-septième et dernier volume est paru, en même temps que l'intégrale de cette volumineuse chronique - 2176 pages dans l'édition papier.