Thomas Pynchon avec un roman noir, voilà qui
était assez inattendu après Contre-jour.
A moins de considérer que son deuxième roman, Vente à la criée du lot 49, utilisait déjà les codes familiers aux
lecteurs du genre. Et Vice caché
serait donc sa deuxième incursion sur ce terrain, avec au centre de l’intrigue
un détective privé, Doc, et autour de lui assez d’éléments pour détourner
l’attention du nœud narratif.
L’auteur de V. ne
sera jamais, a-t-on quelques raisons de penser, celui d’un roman confortablement
installé sur les rails parallèles qui conduisent, de préférence à l’heure
prévue, d’un point à un autre. Il préfère les voies tortueuses et les
aiguillages multiples, les trains qui ne respectent par les horaires et qui
transportent des foules hétéroclites, traversant des paysages peints de
couleurs vives sous un ciel digne de celui qu’évoquaient les Beatles dans Lucy in the sky with diamonds. Bien que
Pynchon ne parle pas des « Fab Four » dans Vice caché. Mais, sur la porte du bureau de Doc, la plaque porte la
mention : « LSD Investigations,
LSD, comme il l’expliquait quand les gens demandaient, ce qui n’était pas
souvent, étant l’abréviation de “Localisation, Surveillance, Détection.” »
Nous sommes à Los Angeles au début des années 70. Richard
Nixon plane comme une ombre malfaisante au-dessus de ceux qui vivent sur la
plage, décidés à prendre leur pied plutôt que d’aller faire la guerre au
Vietnam, et « il distribue des
poignées de biftons à tout ce qui ressemble de près ou de loin à des forces de
l’ordre locales. » Doc, trop habitué aux joints pour être du bon côté
de la barrière, est dans le collimateur d’un représentant local de ces forces
de l’ordre, Bigfoot, aux méthodes peu orthodoxes. Définitivement l’enfoiré de service.
Pas très différent de Doc, au fond, qui ne respecte pas grand-chose. Amis ou
ennemis ? Ordre ou désordre ?
Mickey Wolfmann a disparu. Ce qui, en raison de la surface
financière du bonhomme, fait désordre. Si l’on considère en revanche son
pouvoir de nuisance comme promoteur immobilier, sa disparition est peut-être
une manière de remettre de l’ordre dans un monde dévoué au fric. Néanmoins,
Shasta, la maîtresse de Wolfmann, et parfois de Doc, est bien ennuyée. Bigfoot
aussi, pour d’autres raisons. La ville, sous la menace de problèmes raciaux
exacerbés par les émeutes de 1965, ressemble de plus en plus à une pétaudière.
Comme le roman, qui semble nous filer entre les doigts. Le salon de massage que
visite Doc en croyant tenir une piste s’est transformé en cauchemar. Plus de
pensées confuses que d’avancées dans l’enquête. La faute à un abus de cannabis,
comme semble le penser Bigfoot ?
A la fin, il y aura de la musique partout, en particulier un saxophone
et une voix de femme qui liquéfie Doc. Ainsi qu’une solution partielle à
l’énigme de départ, avec des questions qui restent en suspens et une sorte
d’apaisement, ou ce qui peut y ressembler le plus à la fin d’une histoire
agitée. On l’aura traversée à la manière d’un surfeur porté par les vagues,
avec ensuite le vague soulagement, proche de la frustration, de reprendre pied
sur le rivage. Comme l’écrirait Pynchon : genre, c’est déjà fini ?
Oui, mais on se souviendra du voyage.
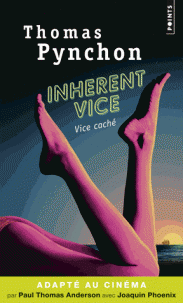





A noter le formidable travail de traduction (Nicolas Richard, qui a œuvré également avec brio pour Fonds Perdus) !
RépondreSupprimer