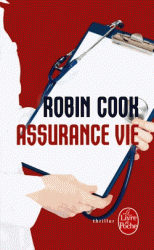Je suis comme Bernard Pivot. Il prend du retard dans ses lectures d'été en vue du prochain Goncourt. Je prends du retard dans la rédaction de ce blog. Pourtant, je suis certain de regarder moins de matchs que lui. Mais la Coupe du Monde de football est là et il est difficile d'y résister, même sans être aussi passionné que l'ancien animateur d'Apostrophes.
Combien d'académiciens français suivent-ils cette compétition? Je l'ignore. Ils ont, aujourd'hui, pris le temps d'élire, après trois tours de scrutin, Marc Lambron au fauteuil 38. Un jeunot: il est né en 1957. Mais ce conseiller d'Etat, critique littéraire à ses heures, a pris le temps de publier une quinzaine de livres dont le plus récent, Tu n'as pas tellement changé, est paru il y a quelques mois. Je ne l'ai pas lu, je viens de l'ouvrir, je vais m'y remettre dès que je vous ai posté cette note.
Je n'y parlerai pas de ses premiers ouvrages. Je les avais trouvés insupportables de fausse légèreté et de vraie prétention. Ensuite, cela s'est mieux passé. Voici les articles que j'avais écrits sur quatre de ses romans, parus entre 1993 et 2004.
Il ne suffit pas d’avoir publié des romans pour être
romancier. Les deux premiers romans de Marc Lambron avaient tout de jeux
gratuits dans lesquels on ne le suivait que de loin, en déplorant le gâchis que
représentait ce talent mis au service de… presque rien. Et puis, voilà que L’œil du silence, cet automne, débarque
avec fracas dans la rentrée littéraire, se frayant un chemin à larges coups d’épaules
jusqu’aux prix littéraires – s’il n’avait pas eu le Femina, il aurait peut-être
pu recevoir le Goncourt lundi –, ce qui ne ressemble guère au jeune écrivain
maniéré qu’était Marc Lambron dans L’Impromptu
de Madrid et La nuit des masques.
Marc Lambron lui-même paraît avoir conscience de ce
changement : « J’imagine que,
quand on écrit, il y a toujours une période d’essais, d’apprentissage, qui pour
moi coïncidait avec mes deux premiers romans. Cette fois-ci, j’ai eu envie de
poser la question d’un éventuel roman au sens romanesque, avec plus de volume,
plus d’ambition, plus de travail. Je m’en suis donné les moyens puisque j’ai
pris dix-huit mois de congé sans solde et que je me suis mis au pied du mur.
Ensuite, c’est un roman écrit sur un personnage authentique, vrai, qui m’a
contraint à aller chercher le plus loin en moi et, donc, bien que ce soit
paradoxal, c’est mon roman le plus personnel. »
Le personnage réel s’appelle, dans sa vie comme dans le
roman, Lee Miller. Née en 1907, morte en 1977, elle fut photographe, et
notamment pendant la deuxième guerre mondiale. Marc Lambron utilise des points
de repère purement biographiques, mais aussi sa liberté de romancier. Celle-ci,
parfaitement maîtrisée et mise au service de son livre, lui a permis de piéger
pas mal de lecteurs qui découvrent seulement à la dernière page que Lee Miller
a réellement existé. « C’est un bon
exercice de mentir vrai, comme dirait Aragon. J’ai construit le livre comme un
authentique roman, et je comptais sur l’effet d’une découverte graduelle qui
vient avec les flash-back. »
Marc Lambron utilise quelques procédés simples. D’une part,
le roman est censé avoir été écrit par un Américain qui a connu Lee Miller,
donc traduit ensuite en français. « Cela
m’interdisait une certaine afféterie, une certaine coquetterie trop française. »
D’autre part, le récit suit une ligne double: une ligne géographique qui
correspond au voyage de Lee Miller, dans les derniers mois de la guerre, de
Paris vers l’Europe centrale, en passant par la découverte des charniers, et
une ligne temporelle qui permet de remonter dans son passé et de découvrir
progressivement ce qu’elle fuit, quel souvenir atroce elle ne peut plus
supporter.
Ces deux procédés disparaissent cependant dans l’épaisseur
du roman, car celui-ci transmet véritablement la profondeur de ses personnages,
qu’ils soient réels ou imaginaires. D’ailleurs, quand on est arrivé au terme du
voyage, et qu’on a tout compris, on ne croit plus qu’il peut exister une autre
Lee Miller que celle racontée par Marc Lambron. « Une femme qui dit : Cette guerre était excitante. Horrible,
et vraiment excitante, est quelqu’un qui revient de loin, et pas seulement de
la guerre. Le goût qu’elle a eu de la guerre, paradoxalement, c’est le fait que
le goût de l’amour a été soudain à l’unisson de ce qu’elle avait ressenti d’assez
obscur et d’assez déchiré en elle depuis le début. »
Toujours en première ligne, Lee Miller semble à peine happer
le réel. Elle cadre, déclenche, recommence jusqu’au bout de son film et puis
envoie la pellicule à Londres pour le développement. Elle ne voit pas elle-même
les photos qu’elle prend. À peine l’image a-t-elle été devant ses yeux qu’elle
a déjà disparu…
L’œil du silence
est un roman saisissant, avec quelque chose de barbare et de fondamental. Il n’explique
pas la violence du monde, mais, au moins, il en donne une vision qui ne cache
rien de ce qu’elle est.
Marc Lambron avait déjà abordé la période de la Deuxième
Guerre mondiale, dans L’œil du silence
qui lui avait valu le prix Femina en 1993. Si les rumeurs de l’époque avaient
un fondement, les dames de ce jury avaient d’ailleurs, à l’époque, bousculé le
calendrier des prix littéraires d’automne pour couronner un roman qu’elles
voulaient absolument à leur palmarès, et qu’on citait aussi comme favori du
Goncourt. Depuis 1993, le Femina est donc attribué avant le Goncourt, et c’est
peut-être à Marc Lambron qu’on le doit – bien involontairement de sa part,
certes.
Voilà pour l’anecdote de la vie littéraire parisienne.
Pour le reste, c’est-à-dire l’essentiel, il y a ce nouveau
roman, 1941, qui commence comme une
histoire à la Modiano. En 1978, un jeune homme rencontre une jeune femme,
Caroline, et apprend que les parents de celle-ci ont joué tous les deux un rôle
dans la France occupée : le père, Pierre Bordeaux, a été Adjoint au
Directeur des affaires politiques de la France Libre de 1941 à 1945 ; la
mère, Carla, n’est pas seulement une figure du mouvement psychanalytique
français, elle était aussi à Vichy en 1941. A quel titre ?
C’est là où commence non pas une enquête aux images floues
comme Modiano en mène si souvent, mais un roman balzacien dont le narrateur
principal est Pierre Bordeaux lui-même. « Le
choix technique est aussi un choix éthique », explique Marc Lambron. « Je me suis notamment demandé qui
allait parler. Pas un maréchaliste, de crainte d’un effet d’empathie. Ce qui m’intéresse,
c’est d’être à la fois dedans et dehors. Bordeaux est pris dans le paradoxe de
son époque : la condition de son impunité, c’est d’être pétainiste en
apparence. Voilà pour le point de vue. Il fallait aussi trouver un ton. Ni l’héroïsme
ni la culpabilité ne me paraissaient possibles. Alors, j’en ai fait un comptable
de l’époque. Il faut dire les choses, en finir avec le placard. Mais ce n’est
pas un roman affirmatif, c’est un roman interrogatif. »
En 1940, Pierre Bordeaux est entré en dissidence :
Vichy lui paraît inconcevable, la voix du général de Gaulle le séduit. L’année
suivante, quittant l’ambassade de Madrid où il était en poste, il est nommé à
Vichy, précisément. Ce qui lui permet d’être recruté indirectement par Londres
afin d’être prêt, sur place, à communiquer l’un ou l’autre document
confidentiel auquel il aurait accès. Sa fonction officielle cache donc
désormais un rôle de taupe et, sous la comédie des apparences, il est
susceptible de servir une cause plus noble…
« Le déclencheur
de ce livre a été l’ouvrage de Pierre Péan, Une jeunesse française, consacré à François Mitterrand. En le
lisant, j’ai très bien compris la trajectoire de François Mitterrand mais j’ai
éprouvé une grande perplexité à propos de l’arrière-fond. Cela se passait
quinze ans avant ma naissance, ce qui créait chez moi un effet d’étrangeté, d’éloignement,
mais j’ai ressenti cette envie d’aller au cœur du nid de vipères. »
Marc Lambron a vu Vichy comme un décor de théâtre, voire
même un décor d’opérette : un hôtel, avec des labyrinthes de couloirs où se
croisent des femmes perdues…
Puis vient Clara qui n’a rien, elle, d’une femme perdue.
Elle est le contact de Pierre Bordeaux qui, bien sûr, tombe amoureux d’elle. L’intrigue
se noue sur plusieurs plans qui sont parfois contradictoires : les amants
manquent un peu de prudence et mettent leur mission en péril. Il n’empêche qu’ils
vivent dans la double exaltation de leur amour et de ce qu’ils accomplissent –
bien que, longtemps, Pierre Bordeaux se demande pourquoi Clara, qui a la
nationalité suisse, s’est engagée dans cette lutte : elle est juive, ce
qui est en effet une bonne raison.
Des descriptions finement ciselées placent les personnages
au sein d’un monde en effet étrange, où les rôles se distribuent dans l’ombre,
où un médecin presque fou veille sur le maréchal Pétain, où différentes
factions agissent les unes sur les autres afin d’acquérir un peu de pouvoir en
plus. « Je suis très précautionneux
sur le factuel », dit encore Marc Lambron. « Quand j’avance quelque chose d’historique, c’est corroboré par l’histoire.
Pour le reste, le roman joue son rôle : il avance des hypothèses, avec des
gens qui sortent des mondes de Proust et de Céline. »
Ces hypothèses séduisent, car elles sont le mécanisme même d’un
roman dans lequel les êtres se révèlent, à leurs propres yeux autant qu’aux
nôtres
Bien malgré lui, Marc Lambron est l’homme par qui le
scandale arrive. On s’en souvient peut-être : en 1993, L’œil du silence, son quatrième roman,
était le favori du Goncourt comme du Femina. Et le jury de ce dernier prix en
avait avancé la proclamation pour avoir la certitude d’inscrire le titre à son
palmarès. La prééminence du Goncourt battue en brèche, il allait falloir attendre
un peu avant de trouver un accord sur l’alternance de la chronologie des
attributions de prix, telle qu’elle est en vigueur aujourd’hui.
Débarrassé des pressions du Femina, hors sujet pour le
Médicis, Etrangers dans la nuit n’est
en lice cette année « que » pour le Goncourt et le Renaudot. Et
applique, avec le savoir-faire qu’on connaît à l’auteur, la méthode Lambron aux
années soixante.
On ne sait pas vraiment où est l’essentiel du roman, dans
les personnages, ce qu’ils vivent et sont, ou dans la reconstitution de ces
années folles, désignées souvent par l’appellation non contrôlée de golden
sixties et qui furent aussi les années de l’assassinat de Kennedy, de la
drogue, de la guerre du Vietnam… Côté personnages, une double figure de femme
domine le récit, deux sœurs américaines d’une beauté piquante et qui séduiront
le même homme, le journaliste Jacques Carrère, à quelques années d’intervalle.
Tout commence à Rome, en 1960, dans des décors de cinéma
italien où Tina White accroche la lumière comme la future vedette dont tout le
monde lui promet le destin. Mais Tina est folle et droguée, l’histoire d’amour
que vit Carrère avec elle est une succession de nuits où l’on plonge de plus en
plus loin vers l’enfer. Arrive Kate, sa sœur aînée, pleine de bonne volonté et
acharnée à sortir Tina de cet engrenage. Le rapatriement vers les Etats-Unis
est organisé de manière musclée, disparition de Tina, fin du premier épisode.
Plus tard, quand Carrère retrouvera les deux femmes, Kate
est devenue une journaliste appréciée, Tina navigue à vue, au risque de couler
à nouveau, dans l’entourage d’Andy Warhol, le Vietnam fait l’actualité et
rapproche, professionnellement d’abord, puis de manière plus intime, roulés qu’ils
sont dans tous les sens par les événements, les deux journalistes, le Français
et l’Américaine. Kate prend la place de Tina, mais peut-être est-ce la même
femme qu’au fond de lui il aime, avec une identique frénésie déplacée de
quelques années.
Résumée ainsi, l’histoire de ces personnages ne prend pas en
compte le montage que Marc Lambron a réalisé autour d’eux, afin de faire
apparaître, selon l’éclairage, tel ou tel pan de leur parcours. L’essentiel du
livre est constitué par un récit de Jacques Carrière où alternent des parties
construites et des pages de notes au jour le jour. Quelques ajouts de Kate
donnent une version légèrement différente des mêmes événements. Et c’est une
dizaine d’années plus tard qu’un autre Français entre en possession de ces
pages troublantes. La mise en perspective a quelque chose d’affolant, et qui
affole d’autant plus qu’une énigme non résolue apparaît et disparaît, comme un
dessin dans le tapis.
Il y a, dans le livre, des morceaux de bravoure qui
émerveillent et irritent en même temps. Chez Andy Warhol ou dans la jungle qui
explose de toutes parts, Marc Lambron semble avoir tout vu, y être allé, avoir
vécu. Mais le romancier, pour mieux nous en convaincre, en fait un peu trop. Et
ces pages qui devraient nous transporter au cœur de l’action nous en éloignent,
comme du cinéma-vérité appuyé.
Reste malgré tout qu’une époque entière est restituée dans
une vision éclatée qui refuse une lecture unique des événements et s’autorise
les diversions de la vie. La musique est aussi présente dans le décor qu’elle
pouvait l’être dans les années soixante et on se surprend à entendre des
refrains dont le titre, traduction d’un immense succès, n’est pas le moins
présent à l’esprit.
Rome, Paris, New York, Danang forment une géographie
inscrite dans le temps de nos mémoires, et Marc Lambron secoue celles-ci pour
en réveiller les moments les mieux profondément enfouis. Lacan passe par là,
qui lui aussi voulait exhumer des bribes et construire une compréhension. Dire
qu’on a tout compris après avoir lu L’œil
du silence serait excessif. Mais on a, quand même, passé de bons moments de
nostalgie inquiète.
Marc Lambron, cette fois, n’a pas eu besoin de documentation
comme ce fut le cas pour L’œil du silence
ou 1941, par exemple. Il lui a suffi
de rafraîchir ses souvenirs et d’y placer ses trois personnages, pour raconter
le ballet de leurs existences pendant la trentaine d’années écoulées. Un garçon
et deux filles en 1975, quand ils se rencontrent. Un homme et deux femmes en
2004, quand ils se retrouvent. Les mêmes, bien entendu : Pierre, Claire et
Karine, dans leur ordre d’entrée en scène.
« Que l’on ne
compte pas sur moi pour la nostalgie », affirme Karine. C’est un
choix. Confirmé immédiatement quand elle affirme avoir été, en 1975, une conne.
C’était la saison des amours. Les trois personnages s’étaient tout de suite remarqués.
Compétition dans laquelle il y a toujours au moins un perdant. Une perdante, en
fait : Karine, quand elle comprend que Claire et Pierre se plaisent. La
gagnante se souvient : « Nous
étions comme deux danseurs de comédie musicale volant au-dessus des eaux. Si l’un
de mes plus beaux souvenirs de jeunesse ressemble à une carte postale, je n’y
peux rien, c’est idiot et c’est vrai. »
Ensuite, les routes se séparent. Et chacun de se construire
une existence qui repose cette fois sur du concret. C’est moins drôle. Il faut
utiliser les armes dont on dispose. L’intelligence de Claire, le charme
singulier de Karine, les relations de Pierre… Les années passent avec leurs
lots d’aventures en tout genre, avec la découverte d’autres horizons. Les
Etats-Unis, l’Espagne, le monde…
Le récit des années pendant lesquelles les trois
protagonistes installent leur carrière professionnelle et se brûlent en amour
est découpé en tranches. Les voix se succèdent et se répondent, car le contexte
est le même, mais vécu de manières différentes. Les centres d’intérêt varient,
l’importance des événements aussi.
C’est la traversée de trente années pas particulièrement
glorieuses, au cours desquelles cependant bien des choix sont encore possibles.
Le monde a changé, il faut s’y adapter et interpréter les modifications
intervenues dans l’environnement proche. A travers les réactions des
protagonistes, la complexité de la société et les nouveaux enjeux qui s’y font
jour sont mis en lumière bien mieux que dans un essai.
Car Marc Lambron a l’art de reconstituer les époques.
Puisque celle-ci est la sienne, il le fait avec la précision d’un entomologiste
qui a de la grâce dans le trait.