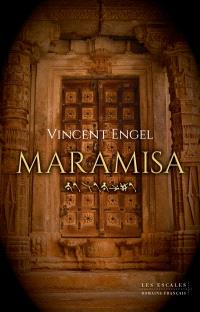Que Paris paye !
Prépare ton cœur, Paris ! après un an, tu vas les revoir, les
poilus !
Ils en ont subi depuis ! ils en ont fait du chemin ! ils en ont
pris des cotes, des célèbres et des inconnues ! et trois fois en 1918, ils
ont sauvé la France, le 21 mars, le 27 mai, le 9 juin.
Ils en ont passé une année ! Souviens-toi : ils sortaient à
peine de tes acclamations, l’autre juillet, que dans les Flandres, accompagnant
les Anglais, ils se jetaient sur le Boche. Il pleuvait ! Si vous aviez vu
comme il pleuvait, vous auriez eu pitié. Quand il pleut dans les Flandres,
l’eau ne vous tombe pas seulement du ciel, elle monte de la terre. Ils étaient
trempés jusqu’aux os comme on dit. Sous ce déluge, le sang qu’ils perdaient ne
tardait pas à devenir pâle. C’était en août. Ah ! ils ont grelotté les
gars ! C’est Anthoine alors qui les conduisait.
Ils ne perdaient pas de temps. Quinze jours après c’était Verdun. Vous
savez : le Mort-Homme, le Talou, la cote 304. Sur la route sacrée de
Bar-le-Duc à la forteresse, ils roulaient, en chantant. Je sais bien qu’ils ne
veulent pas lire qu’ils aient jamais sauté. Ce n’est pas par gaieté bien sûr,
que vous sautiez, mais vous sautiez et pour ceux qui vous regardaient, ça fait
bien ; laissez-nous donc dire que vous sautiez, puisque c’est vrai. Et le
lendemain vous enleviez le Mort-Homme, le Talou, 304. Quelle préparation
d’artillerie ! quels barrages ! Et vous avez traversé les barrages et
le ravin de la Mort aussi. Vous avez arraché aux Boches la vue de Verdun. Vous
avez découronné le kronprinz. Ah ! il ne pleuvait pas cette fois !
quelle chaleur ! L’atmosphère était livrée à d’infinies petites bestioles
qui, sans seconde, comme une riche de moucherons, vous dévoraient la face. Les
pauvres gars ! C’était sous Guillaumat.
Puis il fallait songer à l’hiver. Or, pour bien passer l’hiver – pour
bien passer l’hiver en villégiature dans les tranchées – il fallait, par
ailleurs, enlever la Malmaison. Et vous voilà sur l’Aisne. Ce n’était pas une
paille à déplacer que ce fort-là ! Vous deviez descendre du
Chemin-des-Dames, puis remonter, puis nettoyer les fameuses carrières de
Soissons, bivouacs de bataillons allemands. Ce fut peut-être bien un de vos
plus gros travaux. Et vous avez enlevé tout ça en deux heures ! Vous avez
même enlevé plus qu’on ne vous avait dit. Vous êtes descendus jusque sur
l’Ailette, vous avez pris Pinon.
Puis il y a des gens qui se sont mis à crier : « Laon !
Laon ! » Mais Laon, cela ne vous regardait plus, vous pouviez bien
prendre sur vous quatre kilomètres de supplément, mais c’était tout. C’était en
octobre. Treize mille prisonniers. Maistre commandait.
*
Mais on n’en a jamais fini dans ce métier. Voilà les Allemands qui
foncent sur l’Italie. Ils veulent prendre Venise, Padoue, Vérone, peut-être
même la Lombardie, alors on vous pousse dans des trains et, roule vers le
sud ! Vous n’étiez pas reposés, mais vous roulez. Vous passez sur la Côte
d’Azur, c’est presque la saison : novembre. Hélas ! les mimosas des
gares, seuls, embaument pour vous ! Vous arrivez à Milan. Milan vous porte
dans ses bras. Vous traversez Brescia : acclamations. Vérone vous
voit : la Vénétie reprend confiance. Au bruit de vos pas, l’Italie a
sursauté ; ses soldats, qui sont du même sang que vous, se raccrochent
devant de tels témoins ; ils se rappellent qu’ils savent mourir.
L’Allemand est arrêté. Vous montez dans les âpres secteurs. L’Allemand renonce.
À votre tête était Fayolle.
À ce moment une rumeur se met à courir le monde : Ludendorff et
Hindenburg, riches de leurs armées de Russie, vont porter un coup sans
rémission sur vous autres, en France. Pendant trois mois : janvier, février,
mars, on ne parle que de ça. Il n’y a que vous qui n’en êtes pas troublés.
Derrière vos fils de fer rouillés vous continuez, sans une ombre visible sur le
visage, votre terrible vie d’hommes admirables. 21 mars, l’Allemand
attaque, ce n’est pas sur vous, c’est sur l’Anglais. L’Anglais est obligé,
malgré sa bravoure, d’abandonner un peu de terrain, de votre terrain. Vous vous
précipitez dans la brèche. Vous vous frayez passage ; vous le bousculez, à
travers ses rangs. Vous arrivez à l’ennemi, vous cognez. L’ennemi veut vous
séparer de votre allié et filer entre vous deux. Mais plus la main de votre ami
s’éloigne, plus vous avancez la vôtre pour garder le contact. Cette suprême
défense de votre génie et de vos forces dure dix jours. Le 31 mars,
l’Allemand est ceinturé. Mais vous êtes sans limites dans votre effort. Vous
avez détourné l’avalanche, vous avez barré Amiens et vous voilà dans le nord,
barrant Calais. Ce n’était pas assez. Le 27 mai, toute l’avalanche
allemande est sur vous, pour vous tout seuls. La Marne, frissonnante, se lève
de sa gloire et vous appelle : vous répondez. Vous la sauvez.
Quatorze jours plus tard, le 9 juin, l’Oise à son tour, effrayée,
vous appelle. Vous la sauvez, vous avez sauvé la capitale.
*
Le lendemain de ces grands jours sanglants, j’étais à Paris. Les civils,
les soldats, les femmes, ceux qui sortaient des antichambres où toutes
informations abondent, ceux qui pacifiquement quittaient leur domicile, les
personnages dirigeants, les citoyens dirigés, tous ceux qui me reconnaissaient
se précipitaient sur les revers de ma tunique et, sans souci d’une élégance
d’ailleurs usée, me les cassant encore davantage, me demandaient :
— Qu’est-ce qui se passe ?
Ils sentaient qu’ils étaient sauvés. Toutes ces semaines-ci, des lames de
fond les avaient sortis de leur lit. Ils voulaient qu’un de ceux que le souffle
de la bataille avait effleurés leur donnât des assurances.
— Qu’est-ce qui se passe ? répétaient-ils.
Je leur ai parlé de vous, soldats, qui, demain, allez venir chez eux. Je
leur ai dit ce que, pendant quinze jours, sur les routes réveillées de la
Marne, je vous avais vu accomplir de surhumain dans l’insomnie et la douleur.
Je leur ai parlé de votre figure que la fatigue ne revêt que d’un voile,
derrière quoi, l’heure venue, affleure le même sang de toutes vos victoires. Je
leur ai dit : « Après avoir roulé dans les trains, ils roulaient dans
les camions, et sortant de la poussière, comme des dieux d’un nuage, ils se
collaient à la rive sacrée et l’ennemi s’y brisait. » Je leur ai montré
vos divisions donnant depuis le 21 mars, arrachées brusquement de la terre
qu’elles venaient de préserver, jetées sur la nouvelle terre qu’on nous voulait
voler et des débris de votre héroïsme, barrant la seconde route où
s’engouffrait le Hun. Je leur ai dit que le commandement était forcé de vous
crier : « Assez » et de vous remplacer, car dans l’action vous
ne vous aperceviez pas que la dépression physique allait devenir maîtresse de
votre élan moral. Je leur ai dit qu’au début de l’attaque chaque homme ne
voyant que son secteur, et ne sachant pas la disposition que l’armée était
forcée de prendre, retraitait en colère, disant pour ce qui regardait les mètres
de sol dont il avait la garde : « Mon bon Dieu, nous aurions
tenu ! » J’ai ajouté que désormais tout était en place.
Ils ne m’ont rien demandé d’autre. Maintenant, Paris, paye !
Le
Petit Journal, 13 juillet 1918.
Aux Editions de la Bibliothèque malgache, la collection Bibliothèque 1914-1918, qui accueillera le moment venu les articles d'Albert Londres sur la Grande Guerre, rassemble des textes de cette période. 21 titres sont parus, dont voici les couvertures des plus récents:
Dans la même collection
Jean Giraudoux
Lectures pour une ombre
Edith Wharton
Voyages au front de Dunkerque à Belfort
Georges Ohnet
Journal d’un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914. Intégrale
ou tous les fascicules (de 1 à 17) en autant de volumes
Isabelle Rimbaud
Dans les remous de la bataille