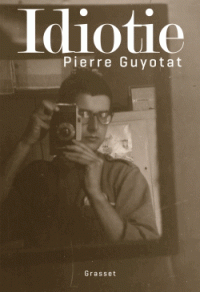C'était le jour des lycéens et de leurs prix. Le Goncourt des jeunes, forcément très attendu, va à David Diop pour Frères d'âme, un roman dont je vous parlais dès le 22 août - et vous avez été 1.206, si les statistiques de Google ont quelque chose à voir avec la vérité, à lire cette note de blog. Les autres, allez-y!
J'avoue que j'avais un faible pour Adeline Dieudonné et son premier roman, La vraie vie. Je l'avais d'ailleurs appelée avant-hier pour lui faire raconter sa tournée des lycées dans le cadre de la préparation du Goncourt des Lycéens. Tournée à la dernière date de laquelle elle avait été fêtée - c'était son anniversaire! Les lecteurs du Soir ont lu cela hier ou ce matin.
Adeline et ses fans se consoleront avec le Renaudot des Lycéens, qui n'avait été précédé d'aucun tapage mais dont a appris, quelques minutes avant l'annonce du Goncourt des Lycéens, qu'il allait à... La vraie vie. Un livre sur lequel j'avais publié (toujours dans Le Soir) l'article qui suit. C'était le 1er septembre, le roman n'avait pas encore reçu le Prix du roman Fnac, il n'était pas encore en tête des meilleures ventes, ce qu'il allait faire ensuite...

Nous ne l’avions pas vue venir. Les signes étaient pourtant
là. Adeline Dieudonné a été primée par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour
une nouvelle, Amarula, un joli tour
de passe-passe amoureux et mortel. Une autre nouvelle, Seule dans le noir, moment de solitude face à une hécatombe, a été
publiée chez Lamiroy qui l’a accueillie aussi dans des ouvrages collectifs –
dont Femmes des années 2020, qui paraît
ces jours-ci. « Klaxon » ne dure qu’un instant, lourd d’une drague
pesante. Ajoutons-y le mordant d’un monologue qu’elle a joué seule en scène, Bonobo Moussaka.
Si vous l’aviez manquée jusqu’ici, rassurez-vous. On ne
parle plus que d’elle, un peu comme d’Amélie Nothomb en 1992 quand elle a sorti
Hygiène de l’assassin – et en
compagnie de qui Adeline Dieudonné se retrouvera la semaine prochaine dans La grande librairie. Son premier roman, La vraie vie, vient de recevoir le Prix
Première Plume. La version audio, enregistrée par elle-même, est en bonne voie.
Les traductions sont annoncées en Italie, en Angleterre, aux Etats-Unis. Le
Livre de poche a acheté les droits. On en passe. « Le milieu me fait un accueil de dingue », nous
disait-elle.
La vraie vie est
un roman qui ne ressemble à aucun autre, cruel et jubilatoire, délirant et
malgré tout conduit d’une main sûre vers un inévitable drame, dans une famille
au sein de laquelle on ne voudrait pas vivre mais qu’il est plaisant de côtoyer
sur papier.
Il devenait nécessaire d’en savoir plus, elle a donc répondu
à nos questions.
L’atmosphère familiale de
« La vraie vie » est
effrayante. Les parents ont installé un rapport de forces déséquilibré et à sens unique dans lequel les enfants
cherchent les moyens d’exister. Avez-vous construit cela un peu à la fois ou le
schéma est-il arrivé d’un bloc ?
Non, ça s’est construit au
fur et à mesure. J’anticipe très peu en écrivant, mes personnages se dessinent
et se révèlent en cours de route. D’ailleurs je me laisse souvent surprendre
par leurs réactions, ce qui est assez jouissif pour moi.
L’héroïne invente des histoires, pour ses marionnettes mais, au fond,
surtout pour elle-même. Vous ressemble-t-elle ? La fiction est-elle une
porte de sortie ? Mais la réalité ne revient-elle pas toujours en
boomerang ?
Oui, il y a un parallèle
avec moi c’est évident. Pendant que j’écris ou pendant que je lis, je me
soustrais un peu à la réalité. Après, non, elle ne revient pas en boomerang.
L’écriture crée un champ de force autour de moi qui me permet d’appréhender le
réel avec un tout petit peu plus de distance. C’est pour ça que j’aime écrire
le matin, parce que le champ de force reste plus ou moins actif pendant la
journée.
Et puis c’est aussi une
purge. Le mot n’est pas très joli, désolée, mais c’est vraiment ça. C’est un
espace qui me permet de sortir mes émotions négatives et d’en faire quelque
chose.
Pour les enfants, il est
indispensable, semble-t-il, d’échapper au père, pour avoir une chance de
survivre. Gilles est trop petit, sa sœur doit donc prendre les choses en mains.
Aussi parce qu’elle est, comme femme en devenir, plus responsable ?
Je ne pense pas que les
femmes soient plus responsables que les hommes. Non, je crois simplement qu’on
peut avoir cette perception parce que tout est raconté de son point de vue à
elle. Et oui, peut-être que son statut d’aînée joue aussi. Mais je n’en suis
même pas certaine. C’est juste qu’elle l’aime, comme on choisit d’aimer quelqu’un
pour des raisons qui nous échappent toujours un peu, à mon avis. C’est
irrationnel. Elle a cette façon d’aimer, qui est presque de l’ordre de la
loyauté. Et puis, elle protège le faible, ce qui la différencie de son père.
Le sommet du roman, si on
ne dit rien de la fin, est peut-être la nuit de la chasse, quand la narratrice
est désignée par son père pour être la proie traquée par les hommes. Le symbole
de ce qu’est souvent la femme dans la société ?
Alors, je n’ai pas cherché
à démontrer quoi que ce soit. Mais a posteriori, je crois qu’il y a de ça, oui.
C’est juste que je suis une femme et que j’écris de mon point de vue. Par
contre, ce que j’aime chez mon héroïne, c’est sa façon de refuser ce statut de
proie, tout en refusant également de devenir un prédateur. En fait, elle refuse
simplement cette vision binaire prédateur/proie. Pour elle, la réalité est plus
complexe, plus riche. Et c’est la connaissance qui lui permet d’accéder à ce
niveau de conscience. Elle n’accepte pas qu’on réduise ses alternatives, elle
reste créative par rapport à ce qu’elle veut faire de sa vie. Le tout, avec une
certaine forme de candeur, qui est sa force colossale.
L’état de la société vous
révolte-t-elle ? Cela semble se traduire dans plusieurs nouvelles (« Seule dans le noir » ou « Klaxon »), se renforcer dans « Bonobo Moussaka » et surtout dans le roman…
Ah oui, c’est évident.
C’est probablement dans Bonobo Moussaka
que je l’exprime de la façon la plus frontale parce que cette révolte a été le
moteur de mon écriture, mais oui, je suis enragée. Et, même si je n’en ai pas
été consciente pendant l’écriture de La vraie vie, peut-être que le personnage du père incarne ce qui me révolte et
m’effraie le plus : la logique binaire.
Pour lui, on est une proie ou un prédateur. Il le dit : « c’est
manger ou être mangé ».
Alors qu’on est confrontés
à des problèmes complexes: on est plus de sept milliards d’êtres humains sur
terre, c’est complexe. Chacun devrait avoir accès à la sécurité, à l’eau, à la
nourriture, aux soins médicaux, tout en préservant le reste du monde vivant,
sans lequel les générations futures ne survivront pas, c’est complexe. Qu’on
soit incapables de s’organiser correctement pour que tout ça fonctionne, c’est
une chose. Mais qu’on regarde les victimes jour après jour en se persuadant que
c’est une fatalité ou en désignant de faux coupables, c’est au mieux de
l’ignorance, au pire du cynisme. Ici en Belgique, je pourrais pardonner au
gouvernement une certaine dose de maladresse et de désorganisation. Mais si on
prend l’exemple de l’accueil des réfugiés, pour ne citer que celui-là, on tombe
juste dans la brutalité binaire et primitive. J’ai honte. Et je suis inquiète
pour l’avenir. Mais il y a aussi des voix qui s’élèvent, plus évoluées, plus
nuancées, plus humaines. Des gens qui agissent. Donc j’imagine que tout n’est
pas encore perdu.