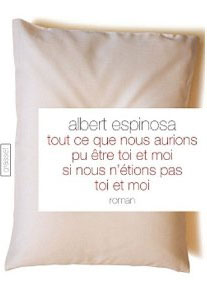Suite du parcours dans les premiers volumes des "romans durs" de Georges Simenon. Aujourd'hui, le tome 2.
Les clients d’Avrenos
Une saison de langueur
entre Ankara et Stamboul, villes cosmopolites qui invitent à traîner de bar en
restaurant, de boîte de nuit en bar... Et rebelote le lendemain, selon un cycle
immuable au cours duquel se rencontrent les mêmes personnes plus ou moins
inactives - et plutôt plus que moins. La légèreté trompeuse avec laquelle
évoluent ces Clients d'Avrenos les place au bord d'un précipice qu'ils ne
voient même pas...
Au sein de cette faune
interlope, Simenon distingue Bernard de Jonsac, personnage sans réelle
épaisseur qui se laisse aller au gré de distractions prévisibles. Et qui nous
paraît aujourd'hui délicieusement suranné. A dire vrai, il l'était peut-être
déjà dès la première publication: Jonsac, en effet, est «drogman» à
l'ambassade de France. La fonction n'a rien d'anglo-saxon, contrairement à ce
qu'on pourrait penser (le mot est d'origine grecque ou arabe). Il s'agit
simplement d'un interprète dans les pays du Levant - mais le titre a été
supprimé en... 1902.
De toute manière, Bernard
de Jonsac fait passer le travail bien après ses plaisirs, au point de se faire
réprimander par l'ambassadeur. Dissipé, le drogman épouse Nouchi, qui est
peut-être hongroise d'origine mais dont la profession ne fait aucun doute:
elle est entraîneuse au Chat noir, un cabaret d'Ankara. Jonsac aime bien Nouchi,
qui longtemps ne lui donne pourtant pas grand-chose d'elle-même, mais pas au
point de lui proposer le mariage. En fait, la belle de nuit est sur le point de
se faire expulser de Turquie et il lui a offert cette solution.
Forcément, elle rencontre
les amis de Jonsac. Dans un premier temps, elle ne les trouve pas intéressants.
Mais, bientôt, elle ne peut plus se passer d'eux, qui lui tournent autour comme
des insectes autour d'une flamme. L'oisiveté porte au badinage, ou plus si
affinités - ce sera longtemps un mystère...
Pendant que sa femme
papillonne, Jonsac repère une jeune fille qui est tout le contraire de Nouchi.
Lelia, en contraste avec le monde perverti où il vit, lui paraît le comble de
la pureté. Qu'il faut corrompre, d'une certaine manière, pour établir un
semblant d'équilibre entre les choses...
Les demoiselles de Concarneau
Jules Guérec est resté un
petit garçon, bien qu'il ait la quarantaine et qu'il dirige la petite
exploitation de pêche familiale. Ses sœurs, ses aînées, sont les véritables
patronnes, surtout Françoise et Céline, qui passent leurs journées à tenir
l'épicerie et les livres de comptes. Marthe est sortie du cercle en épousant
Emile Gloaguen, le secrétaire du commissaire de police de Concarneau.
Mais elle a en quelque
sorte délégué son pouvoir à son mari, considéré comme le seul homme sensé dans
l'histoire. Puisque Jules garde la marque d'une faute passée: un enfant
illégitime qu'il a fallu faire oublier de peur du scandale. Et voilà que Jules,
décidément incapable d'autre chose, fait une nouvelle bêtise, que son
inquiétude double d'une véritable catastrophe. A Quimper où il représentait les
thoniers de Concarneau à la réunion du syndicat, ses pas l'ont mené vers la rue
où traînent les femmes faciles et il y a laissé cinquante francs dont il ne
sait comment justifier la disparition.
Tout à ses pensées
sombres, au volant de sa nouvelle voiture qu'il maîtrise encore mal, dans la
nuit qu'il traverse pour la première fois à la lueur des phares, il n'a pas le
temps de voir surgir un gamin devant ses roues qu'il l'a déjà écrasé. Paniqué,
il ne s'arrête pas tout de suite, revient sur ses pas après un moment, voit un
attroupement, rentre finalement chez lui et choisit de régler le problème des
cinquante francs manquants en annonçant qu'il a perdu son portefeuille jeté
dans des cabinets.
Entre la peur de ses sœurs et de la police, dont son beau-frère est un digne représentant, Jules
mûrit un remords croissant avec ce qu'il apprend de la mère célibataire dont il
a tué un des deux enfants. Marie Papin est pauvre, il entreprend de l'aider en
engageant son frère, à demi simplet, sur un bateau. Sans demander l'avis de ses sœurs qui le prennent mal et y voient une manœuvre destinée à leur cacher
quelque chose. On ne peut pas leur donner tort, d'autant moins que Jules, dans
son désir de racheter sa faute jusqu'au bout, s'imagine déjà marié avec Marie
Papin dont il se croit amoureux. Françoise et Céline, toujours soucieuses de
préserver la cohérence de leur famille, ne peuvent laisser faire cela.
La tension monte, le
scandale éclate, le pauvre Jules ne sait plus où il en est de sa vie ni de ce
qu'il veut en faire...
Le drame familial est
intense, le point de basculement est évident et Simenon a traité ici un de ces
dérapages qu'il affectionnait.