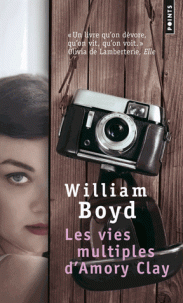La période est décidément faste pour les nécrologues. On s'en désole, bien sûr, et de compter quelques écrivains dans l'embouteillage de cortèges funèbres qui traverse le monde artistique ces dernières semaines. Michel Déon, né en 1919, écrivain depuis 1944, a produit le genre d'oeuvre qu'on n'embrasse pas en 2000 signes (c'est pourtant ce que je viens de faire, les pages papier d'un quotidien n'étant pas extensibles à l'infini - mais je suis certain qu'ils vont y arriver au Figaro, on vérifiera cela demain matin.
J'ai le vague souvenir d'une agréable rencontre avec Michel Déon, à une époque où les articles n'étaient cependant pas archivés électroniquement. Et aussi d'avoir, avant 1995, écrit d'autres choses sur lui - en particulier à propos d'Un taxi mauve lors d'un voyage en Irlande. Tout cela est perdu, ou au moins ne m'est plus accessible. Ce n'est peut-être pas si grave, après tout. Il reste ceci, que je vous confie. Ne les égarez pas.
Même ceux qui le connaissent peu savent combien la Grèce lui
est familière, et qu’il est installé en Irlande. On sait moins, sans doute, qu’il
a beaucoup voyagé – ou plutôt, comme il le précise lui-même : « je crois m’être beaucoup promené en
flâneur sur cette terre et dans les livres d’écrivains que j’aimais. »
Un ouvrage qu’il intitule Je me suis beaucoup promené… rassemble des textes jusqu’à présent
éparpillés dans différents lieux de publication, comme des revues, ou même
oubliés dans un tiroir. Certains remontent aux années cinquante, d’autres sont
beaucoup plus frais. Tous ont en commun de nous faire voyager en sa compagnie, ou
en compagnie de ces écrivains qu’il aime. Tant il est vrai qu’il vaut parfois
mieux rêver sur des textes anciens que de se trouver embarqué dans un tourisme
de masse auquel les lieux ne peuvent de toute manière plus offrir des décors
aujourd’hui détruits. Le mot « voyage » ne recouvre plus l’idée d’un
beau privilège et s’avère de plus en plus décourageant, se lamente Michel Déon.
Se déplacer en avion ressemble surtout à une corvée : « Ce qui était encore un plaisir il y a vingt ou trente ans est
devenu une torture raffinée, aussi raffinée que le parcours d’une autoroute un
dimanche soir de retour à Paris. »
Ah ! Parlez-nous d’un temps où, sur la brève durée d’un
parcours aérien entre Dresde et Francfort, on pouvait faire la rencontre
magique d’une blonde toujours en retard, toujours remarquée. Ou racontez-nous
encore les pérégrinations d’Ulysse, voire Flaubert en Égypte, ou Chateaubriand
en Grèce… Si cela ne suffit pas, passons quelques nuits affolantes en Espagne, parcourons
quelques centaines de kilomètres en automobile (on n’ose pas dire :
« en voiture »), rêvons sur les hasards qui font se recouper les
chemins…
C’est tout cela qu’offre généreusement Michel Déon, poussant
vers le Portugal, traversant l’Italie, se posant quand même plus longuement en
Grèce et en Irlande – il ne songe pas à renier ses amours, et s’explique même
sur son choix irlandais : « Et
maintenant, si vous me demandez ce que je suis allé faire en Irlande, je vous
répondrai que je n’en sais rien au juste, et que, de toute façon, il faut bien
vivre quelque part. Au fond, il s’agissait peut-être d’une envie, mûrie depuis
longtemps, un obscur besoin de pluie, de vent, de prairies vertes, l’attrait
que peuvent exercer une terre mouillée, de vastes paysages, la présence de l’Océan
et le bruit sourd, continu de la houle se brisant sur les falaises de Moher. L’Europe
s’achève ici, plus loin c’est l’aventure. »
Le flâneur de Londres (1996)
Des écrivains français qui, aujourd’hui, ont une certaine
importance dans le paysage littéraire, Michel Déon est sans doute un de ceux
qui connaissent le mieux Londres, succédant ainsi à Paul Morand. On pourrait
peut-être mettre en compétition avec lui un Pierre-Jean Rémy, ou d’autres
auteurs moins populaires, mais certainement pas un Patrick Modiano bien qu’il
entraîne lui aussi ses lecteurs à Londres dans son nouveau roman, Du plus loin que l’oubli. Michel Déon a
passé beaucoup de temps à Londres, entre deux séjours en Grèce ou en Irlande – où
il est installé depuis longtemps.
Le flâneur de Londres,
qu’il vient de publier, est une agréable balade dans des rues colorées où le
changement se marque par-dessus la permanence, comme si la capitale britannique
résistait à toutes les invasions, à toutes les révolutions culturelles, gardant
les traces de celles-ci sans se modifier en profondeur.
Michel Déon contredit souvent la question/réponse qu’il a
placée dans les premières pages de son livre : « Londres est-il encore dans Londres ? Oui pour certains, non
pour d’autres qui, comme moi, gardent le souvenir d’une ville enfermée dans ses
traditions, jalouse de sa personnalité. » Et on pourrait, pour résumer
cette flânerie, lui donner un titre de chapitre à la Jules Verne : Où il
apparaît que tout en subissant les assauts du temps, Londres résiste comme une
vieille dame respectable.
Mais Michel Déon, tout en reconnaissant implicitement, dans
le même temps qu’il la nie, la continuité dans le changement, grogne contre
tout ce qu’il ne reconnaît plus. Il n’est pas l’homme des bouleversements – on
le savait –, bien qu’il accueille avec sympathie le cosmopolitisme effréné d’une
ville capable de tout digérer – tout et son contraire. Des populations venues
des horizons les plus lointains et les plus divers trouvent ainsi place dans un
cadre qui paraît apte à accueillir les excentricités les plus folles en leur
rendant un statut simplement banal.
La promenade de Michel Déon n’est pas seulement géographique.
Certes, il arpente les rues de Londres, il pousse les portes des clubs les plus
sélects, il vérifie la vétusté des chambres de certains grands hôtels, il fait
son shopping dans les boutiques les plus réputées. Mais il découpe aussi, dans
les endroits qu’il traverse, les couches successives que l’Histoire a déposées,
comme des strates dont la structure reproduit fidèlement les convulsions des
siècles passés. C’est à travers elles qu’il lit et retrouve la signification d’événements
dont les conséquences marquent encore le présent – pour son plus grand bonheur,
et pour notre édification.
Il est plus sombre quand il se projette dans l’avenir, quand
il envisage l’évolution future du Londres qu’il aime : « La seule inquiétude – elle est de
taille – vient de ce que cette ville, à juste titre si orgueilleuse de son
passé, semble mal lutter contre le malaise économique et social, contre la
clochardisation des chômeurs. Le spectacle qui déchire le voyageur à Calcutta
ou au Caire, les mendiants, les hommes hâves et en guenilles, est maintenant
monnaie courante à Londres, à cela près que le climat incite ces malheureux à
se protéger dans des emballages en carton. Deux mondes coexistent : l’un n’ayant
rien perdu de sa superbe ; l’autre au bord du désespoir. »
Est-ce le dépit qui, chez lui, provoque la distraction ?
Il date du 1er novembre la floraison des affiches qui lancent :
« Le beaujolais nouveau est arrivé ! » Et, parlant de la
disparition des domestiques, il fait référence au film Les vestiges du jour en oubliant de préciser qu’il était tiré d’un
admirable roman de Kazuo Ishiguro. S’il y avait pensé, cela lui aurait permis
de mesurer aussi combien le cosmopolitisme, dans la foulée d’un empire
britannique décomposé, avait investi la littérature, avec des effets aussi
surprenants que réconfortants.
Au moment où Michel Déon publie son nouveau roman (La cour des grands, chez Gallimard), on
a le plaisir de retrouver au format de poche deux autres fictions antérieures. C’est
en effet toujours avec le même bonheur que ce narrateur brillant propose ses
inventions où un brin de folie secoue l’apparent carcan d’une langue très
classique.
Un déjeuner de soleil
(1981) joue avec une fiction qui nourrit la fiction, avec un personnage d’écrivain
– Stanislas Beren – qui est loin d’être une créature purement intellectuelle
mais dont la personnalité et la vie sont ancrées dans un réel et un imaginaire
savamment confondus. Michel Déon maîtrise l’illusion, et nous fait croire à
tout.
Le jeune homme vert
(1975) est peut-être mieux connu parce qu’il appartient à la grande période de
succès de Michel Déon – il paraissait après Les
poneys sauvages et Un taxi mauve.
C’est un roman picaresque inspiré par la manière de faire de John Fielding, romancier
anglais du XVIIIe siècle. Il plonge un jeune homme dans une
grande aventure européenne de 1919 à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Les élans du cœur, Michel Déon connaît. Et en particulier
ceux qui font naître l’émoi pour la première fois chez un jeune homme à qui la
vie paraît tout promettre. L’âge de l’écrivain ne fait rien à l’affaire : La cour des grands est un roman sur ce
registre. Encore, mais on ne le regrette pas un instant. D’autant que, quand
même, l’auteur a assez vécu pour avoir les moyens de mettre ses histoires d’amour
(celles qu’il invente, au moins) en perspective, dans un regard porté, des
années après, sur ce qui est arrivé. « De
cette chose impalpable, peut-être inexistante qu’est le passé, que
gardons-nous ? A peine quelques mots dont nous ne savons plus s’ils ont
été réellement prononcés ou si c’est nous qui les inventons dans le naïf désir
de nous justifier, de croire que nous avons vraiment existé tel jour, telle
heure cruciale dont le souvenir nous poursuit. »
Revenons en arrière, au début chronologique d’une histoire
qui commence comme un rêve. En automne 1955, le jeune Arthur embarque à
Cherbourg sur le Queen Mary pour
poursuivre des études de droit des affaires aux Etats-Unis. Par la grâce d’un
homme qui s’est penché sur son cas – par quel hasard ? –, il a obtenu une
bourse qui lui autorise cette aventure. Mais l’aventure commence sur le
paquebot, dans un no man’s land qui dure six jours. Les personnages principaux
sont rassemblés là et se rencontrent pour la première fois : Arthur Morgan,
donc, vingt-deux ans ; un trio étrange de jeunes gens composé de Getulio
et de sa sœur Augusta, Brésiliens, et d’Elizabeth, Américaine née dans une
famille d’émigrés irlandais ; Concannon, professeur dans l’université où
Arthur suivra ses cours, brillant mais alcoolique ; et Allan Dwight Porter,
conseiller spécial du président Eisenhower, le bienfaiteur à qui Arthur doit sa
bourse.
Augusta et Elizabeth sont séduisantes, Arthur tombe sous
leur charme sans effort, mais aussi sans être capable de faire un choix entre
les deux. Elles semblent jouer devant lui une parade amoureuse qui ne les
engage à rien, tandis que le jeune homme, pour sa part, se trouve pris dans un
engrenage plus dangereux. Si détaché qu’il veuille être, il y laisse des
morceaux de lui-même, son cœur ne résistant pas complètement aux propositions
non dites qui lui sont faites.
Il ne s’agit donc pas seulement, pour Arthur, de quitter
provisoirement un pays le temps d’en découvrir un autre. Il s’agit aussi de
passer à l’âge adulte dans sa vie sentimentale, même si ce n’est pas facile. Et
il s’agira, un peu plus tard, d’entrer dans la vie professionnelle par le biais
d’un stage, toujours grâce à Allan Dwight Porter qui porte au jeune homme une
confiance reposant sur une intuition. Celle-ci ne l’a pas trompé : Arthur
se montrera digne des espoirs placés en lui.
Mais ses aventures le troublent sans cesse, partagé qu’il
est entre Elizabeth et Augusta. Elles se donnent et se refusent, se font
complices et concurrentes, changeant d’attitude à son égard en moins de temps
qu’il n’en faut pour l’écrire.
Tout cela, à la fin des années cinquante, se déroule dans un
monde où tout semble permis, les pires outrances comme les projets les plus
fous. Getulio, en particulier, incarne avec son tempérament de joueur et de
flambeur une certaine idée de l’Amérique à laquelle Arthur devra bien, d’une
manière ou d’une autre, s’habituer. Un soupçon de cynisme cohabite donc avec, malgré
tout, de la fraîcheur d’âme. Et que l’un n’empêche pas l’autre ne devrait pas
nous surprendre puisque Michel Déon est de ceux qui ouvrent, dans les
personnalités, des abîmes effrayants.
D’abîme, il en est encore question lorsque, tout à la fin du
roman, Elizabeth cite à Arthur cette phrase de Stendhal : « L’amour est une fleur délicieuse, mais
il faut avoir le courage d’aller la cueillir sur les bords d’un précipice. »
La cour des grands
– investie par Arthur presque malgré lui – n’est pas le meilleur roman de
Michel Déon. Il n’empêche : bien d’autres écrivains pourraient se
contenter d’avoir donné, avec une telle sûreté de trait, de pareils moments de
romanesque pur.
Madame Rose est une vieille dame indigne du meilleur cru. Elle
a tout vécu, connu le grand monde, joyeusement éparpillé sa vie avant de se
retrouver, malade et handicapée, à raconter ses souvenirs au jeune cousin
Gaston. Des souvenirs dont elle possède plusieurs versions, et que peut-être
elle invente au fur et à mesure, au moins en partie. Entre son serviteur indien,
son chauffeur voyou et son affriolante dame de compagnie canadienne, Madame
Rose donne des coups de pied moraux - au
physique, elle n’en est plus capable – dans les convenances. Et Michel Déon s’amuse,
comme il nous amuse, à égrener ces hauts faits d’une vie amoureuse très pleine.
En contrepoint, Gaston se cherche, croit trouver une femme, mais
elles sont trois et son père, ministre, connaît très bien l’une d’elles. Un
siècle de dévergondage, sur quoi est-ce que cela débouche ? Sur un roman
comme celui-ci…
La mémoire des lieux est à la fois puissante et pleine de
trous. Edouard garde l’étonnant souvenir d’un appartement que la famille a
quitté quand il avait… un an ! Et d’autres images constituent le puzzle
incomplet d’une enfance déroulée à petite vitesse. S’y ajoutent des personnages
hauts en couleurs, parmi lesquels les parents ne sont pas les moins
spectaculaires. Une éducation s’écrit ainsi, constituée de règles et de
transgressions, de secrets partagés, de rêves inaboutis. On exagérerait en
disant que Michel Déon est ici à son meilleur. Son écriture possède néanmoins,
comme toujours, un charme fou qui agit avec efficacité. Et fait traverser ces
pages comme si on retrouvait dans le personnage un vieil ami longtemps perdu de
vue.
L’Irlande de Michel Déon est pleine de fantômes. Des
fantômes très vivants. Leur stature est celle de personnages romanesques, sur
une terre propice à la confusion entre la réalité et la fiction. « Un
voyageur du XVIIIe siècle s’émerveillait déjà de l’art avec
lequel les Irlandais se moquent de la réalité. » Comme ils ont, en
outre, le « don du bagout » pour imposer leur point de vue,
ils émerveillent l’écrivain. Nous aussi. Chaque rencontre est une découverte.
Et leur succession, un défilé d’instants magiques. Grâce, bien entendu, au sens
aigu du trait vif dont Michel Déon a fait un peu sa marque de fabrique. Son
livre a un atout supplémentaire : contrairement au pays, il ne mouille
pas.
Dans les
années 50, Michel Déon voyage, se regarde voyager et se raconte. Il court un
peu trop vite et doit forcer le trait pour chercher un peu d’originalité, qu’il
ne trouve pas souvent. Dans la succession de clichés alignés par un jeune homme
amoureux de la vie encore plus que des femmes, quelques pages, ici et là,
émergent. Mais on est trop loin du meilleur de l’écrivain pour éprouver autre
chose que de la déception.