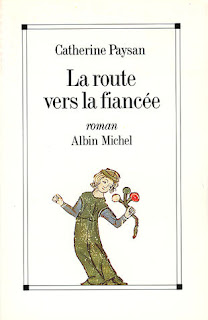Je l'aimais bien, Michel Ragon, même s'il y avait un moment que je n'avais plus rien lu de lui. C'était un homme sincère et sa sincérité transparaissait dans ses livres. Un homme multiple, aussi, dont la mort à 95 ans ne fera peut-être pas de gros titres dans les journaux, mais vers qui on ferait bien de revenir de temps à autre. Son roman le plus populaire reste probablement Les mouchoirs rouges de Cholet qui, en 1984, si mes souvenirs sont bons (les traces écrites manquent), fut l'occasion de notre première rencontre. Ensuite, il y en a eu d'autres, et d'autres lectures. Florilège.
 |
| Photo Thesupermat |
La mémoire des vaincus (1990)
Michel Ragon vient de changer d’époque. Lui qui semblait, au
moins en matière romanesque – car en architecture ou en critique littéraire, c’était
différent –, bien ancré dans la chouannerie donne, avec La mémoire des vaincus, une grande fresque dans notre siècle.
« C’est un choix
délibéré. Je voulais le faire depuis longtemps, mais c’était difficile, parce
que, d’une part, il fallait embrasser des problèmes politiques ambigus et que, d’autre
part, il fallait beaucoup de personnages. »
En politique, Michel Ragon a choisi de montrer, et parfois
même de dévoiler, les rapports entre les anarchistes et différents pouvoirs, en
France, en Russie et en Espagne. Une manière pour lui de montrer – enfin, diront
certains – où il se situe idéologiquement. Du côté des vaincus, mais avec une
foi entière dans la liberté.
Quant aux personnages, il en est un qui domine tous les
autres, parce qu’il est le fil conducteur de tous les événements : Fred
Barthélémy. Au début du siècle, ce petit voyou aurait presque pu faire partie
de la bande à Bonnot. Puis, après la Révolution russe, il s’est retrouvé à
Moscou où il a cru pouvoir rester fidèle à ses idéaux dans l’installation d’un
système qui allait s’en révéler si éloigné. Fred Barthélémy sera aussi à la
guerre d’Espagne, puis deviendra bouquiniste après la Deuxième Guerre mondiale
– une époque du roman où l’auteur lui-même s’avance très peu masqué.
« Fred est un
mélange de plusieurs personnages, mais le dernier est exactement celui que j’ai
connu, à la fin de sa vie. Les épisodes que je relate là sont exacts à un mot
près. Depuis quarante ans, j’avais cette mémoire qui disparaissait, parce que
les gens mouraient, et je ne voulais pas qu’elle se perde. J’ai donc essayé de
la restituer. »
Cette volonté l’a conduit à donner beaucoup de place à l’Histoire,
dans laquelle il met en évidence, d’ailleurs, quelques épisodes peu connus, revenant
par exemple sur l’épisode, récemment utilisé par Henri Coulonges pour La lettre à Kirilenko, des syndicalistes
français trop curieux des côtés les moins exaltants de l’après-Révolution russe
et éliminés pour ne pas pouvoir témoigner.
Michel Ragon se défend malgré tout d’avoir noyé les aspects
romanesques sous la documentation historique.
« Il y a quand
même les personnages de femmes, des aspects propres au roman. Mais il est
certain que l’arrière-fond est tout à fait historique et que ça aurait pu être
seulement un ouvrage historique, comme Les Mouchoirs rouges de Cholet aurait pu
être seulement un livre d’ethnographie. Il y a toujours chez moi ce mélange du
romanesque et de la documentation scientifique. »
Du côté des femmes, Flora, la première compagne de Fred, de
la femme-enfant à la réussite sociale grâce à un peintre célèbre qui a fait d’elle
son modèle et son héritière, est particulièrement émouvante, parce qu’elle lui
reste, d’une certaine manière, fidèle, et que les amants d’autrefois se
retrouvent toujours.
Quoi qu’il en soit, c’est par les aspects historiques que La mémoire des vaincus vaut surtout, à tel
point que son auteur croit que ce roman n’aurait pas pu être publié à n’importe
quelle époque.
« Il y a eu une
telle prédominance du marxisme qu’un éditeur aurait craint de publier un livre
comme celui-là. L’anticommunisme qui s’y trouve, et qui paraît maintenant tout
à fait normal, aurait paru monstrueux il y a seulement vingt ans. »
J’en ai connu des équipages. Entretien avec Claude Glayman (1991)
Michel Ragon est un homme multiple, on ne le sait pas assez.
Ceux qui ont lu ses romans ignorent le critique d’art, ceux qui utilisent ses
ouvrages historiques sur l’architecture ne savent pas qu’il a été, et reste d’esprit,
un compagnon de route des anarchistes. J’en
ai connu des équipages, ouvrage en forme de long entretien avec Claude
Glayman rassemble toutes ces facettes moins disparates qu’il peut y sembler à
première vue.
« Ce qui m’a
intéressé dans le travail de Claude Glayman », confie Michel Ragon, « c’est l’aspect de panorama, d’inventaire
de tout ce que j’avais fait dans les secteurs les plus divers. Et je me suis
aperçu, en faisant cette espèce de biographie, que les choses n’étaient pas
séparées. Au moment où je publiais à propos de la littérature prolétarienne, je
fréquentais le milieu anarchiste et des peintres. J’avais l’impression, rétrospectivement,
qu’il devait y avoir des tranches. Mais non, pas du tout. Cela faisait partie
de ma vie, au même titre. »
Pour simplifier la lecture, Claude Glayman a organisé
thématiquement des conversations dont le premier résultat était, pour reprendre
le mot de Michel Ragon, « monstrueux ». On passe donc en revue ses
différents centres d’intérêt en découvrant chaque fois des anecdotes qui en
disent long.
« Je n’avais
jamais pensé être critique d’art. Je n’en ai pas la vocation. C’est le hasard
des rencontres qui m’a fait connaître très tôt des peintres alors encore peu
cotés. Je me suis passionné pour eux, et j’en ai parlé un peu, puis de plus en
plus. Mais je n’ai parlé que des artistes qui m’intéressaient, dont j’étais un
compagnon. C’est un peu la même chose pour l’architecture, d’ailleurs… Non, pas
exactement. J’ai écrit une histoire de l’architecture qui demandait une
certaine objectivité. »
Sur les architectes, Michel Ragon a quelques idées bien
arrêtées sur leurs rapports avec le pouvoir, et en particulier un pouvoir fort.
Il dit à Claude Glayman : « Ceaucescu hier et Ricardo Bofill aujourd’hui
se placent tout à fait dans la lignée de Speer. C’est l’architecture destinée à
magnifier le pouvoir politique, poussée jusqu’à la démence. » Peu d’architectes
échappent, pour lui, à cette tentation : « Le Corbusier a toujours cherché un pouvoir fort. Il l’a cherché
aux yeux de Staline, il l’a cherché auprès de Pétain… Il faut de grands projets
d’État pour faire de la grande architecture. » Même les grands travaux
du double septennat mitterrandien tiennent de cela : « On pourrait dire que c’est un pouvoir fort, même quasiment
monarchique. »
La littérature prolétarienne l’a attiré par l’intermédiaire
d’Henri Poulaille, qui dirigeait le service de presse de Grasset, mais un creux
de 13 ans les a séparés avant des retrouvailles émouvantes. Ragon lui a
cependant rendu hommage dans La mémoire
des vaincus.
Au fond, ce qui relie tout cela, c’est l’amour de l’écriture.
Sur tous les sujets qui l’ont passionné et le passionnent encore, Michel Ragon
a conçu des livres. Beaucoup de livres, d’ailleurs – sa bibliographie
chronologique en renseigne déjà quatre en 1991, et ce n’est pas fini ! Et
pourtant, le succès populaire lui est venu assez tard, avec L’accent de ma mère, paru en 1980.
« C’était pour
moi un adieu à la littérature à travers lequel j’essayais de retrouver ma
culture à travers ma mère, ma terre, la Vendée, etc. Et puis ce livre a eu une
telle portée sentimentale et publique que j’ai été poussé à continuer. »
Ce furent alors Les mouchoirs
rouges de Cholet, La louve de Mervent
et Le marin des sables, son cycle
vendéen, avant La mémoire des vaincus,
en hommage à ses compagnons anarchistes. Ce sera, dans l’avenir, d’autres
livres encore, par fidélité à la Vendée…
Le roman de Rabelais (1994)
Michel Ragon publie Le
roman de Rabelais, un ouvrage où la biographie prend toute la place et par
lequel nous sommes conviés à une véritable rencontre avec un personnage de
fiction plutôt qu’avec une figure historique – même si la documentation a été
tout à fait sérieuse.
D’ailleurs, au point de départ, Michel Ragon voulait écrire
une biographie traditionnelle, avec l’ambition de boucher enfin, grâce aux
documents qu’il aurait trouvés, les trous habituellement laissés dans la
carrière de Rabelais. Et puis, il a changé de point de vue : « Quand j’ai étalé tous les documents
devant moi, j’ai eu envie de me promener dans la vie de Rabelais, de manière
beaucoup plus libre. J’ai donc mélangé les genres, comme d’ailleurs dans la
plupart de mes livres. »
Michel Ragon a l’art, en effet, d’utiliser ce qu’il connaît
au profit des inventions qui le séduisent. À tel point qu’il ne sait plus
toujours, après coup, ce qu’il a imaginé et ce qu’il a restitué de la vérité. Pas
seulement pour Rabelais, d’ailleurs : « Je
ne sais plus très bien qui est ma mère après avoir écrit L’accent de ma
mère, je finis par mélanger ce qui vient
d’elle et ce qui est venu d’autres personnages que j’ai utilisés pour ce
portrait. »
Donc il était logique de tisser, par-dessus les larges vides
de la biographie, des compléments logiques grâce auxquels Michel Ragon a l’impression
de s’approcher davantage de la vérité. Mais attention : « Il n’y a aucun personnage inventé, à
l’exception du petit moine – qui a son importance, puisqu’il est le seul à
rester fidèle à Rabelais jusqu’au bout. »
Il faut dire que Rabelais, comme tous les écrivains de cour
de son époque, était mêlé, parfois malgré lui, aux polémiques de son temps :
roi français contre pape romain, par exemple, beau cas de figure dans une
situation complexe dont on ne se sort qu’en se montrant assez souple pour
accepter la censure. Souple, Rabelais ne l’était pas trop : quand il était
lancé dans son écriture, comme le montre Michel Ragon quand il le peint en
pleine action, il se laissait aller à son tempérament d’auteur. Encore ne
faut-il pas confondre l’excès de l’œuvre avec celui qui en fut responsable :
« La morale de l’histoire, c’est que
Rabelais n’était pas rabelaisien », dit aujourd’hui le
romancier-biographe.
Une chose est certaine : Michel Ragon n’a pas attendu
le présumé cinq centième anniversaire pour s’intéresser à Rabelais. Il est de
son pays, en quelque sorte : « Rabelais
fait partie, si j’ose dire, de mon identité. J’ai passé mon enfance en Vendée, à
Fontenay-le-Comte, dans la ville où Rabelais a été moine. Il y est aussi connu
que Manneken-Pis à Bruxelles… »
D’ailleurs, il était déjà question de Rabelais dans Enfances vendéennes, un récit
autobiographique nourri de bien des lectures. Et puis, Michel Ragon, libertaire
historien de l’anarchisme, ne pouvait que retrouver plus longuement, un jour ou
l’autre, un Rabelais considéré comme le grand-père de l’anarchisme.
Encore le personnage principal du Roman de Rabelais ressemble-t-il assez peu au portrait que nous ont
présenté souvent les histoires littéraires. D’abord parce que des épisodes peu
connus de sa vie – comme les rencontres avec Calvin ou avec Philibert de l’Orme,
architecte (qui rejoint une autre passion de Michel Ragon) – sont mis en
évidence, selon le bon vouloir du romancier qui articule les événements. Ensuite
parce que Rabelais, homme d’Église, apparaît ici surtout comme médecin, un
aspect de sa carrière qui passe généralement à l’arrière-plan.
Sans doute faut-il, ici, faire un bref détour du côté de l’histoire
personnelle de Michel Ragon qui eut à fréquenter longuement les médecins et les
hôpitaux il y a quelque temps, alors qu’il était en plein travail pour la
conception de son livre. Il ne le reconnaît pas immédiatement, comme s’il
éprouvait quelque gêne à mêler son propre parcours avec celui de son personnage,
mais il finit par dire : « Le
monde médical m’est tombé dessus, et Rabelais m’a aidé à guérir. Ce qui, plus
de quatre siècles après sa mort, témoigne de qualités assez rares pour un
médecin. » Toujours est-il que la proximité de la maladie et même de
la mort a dû pousser Michel Ragon à accorder une importance plus grande à cet
aspect de Rabelais. Sans pour autant fausser la vérité : « J’ai peut-être amplifié certaines
choses, mais c’est lui ! »
C’est tellement lui qu’une fois refermé le « roman »
de Michel Ragon, il ne peut y avoir d’occupation plus pressante que de rouvrir
les œuvres de Rabelais lui-même.
Les coquelicots sont revenus (1996)
Michel Ragon, tous ses livres le disent, ne porte pas un
amour immodéré aux institutions broyeuses d’hommes. Tout ce qui aligne et
uniformise le voit révolté, infatigable défenseur de ceux qui n’ont pas le
pouvoir de résister aux pouvoirs. Le voici donc une fois encore sur la brèche
dans son nouveau roman, Les coquelicots
sont revenus. Les faits se déroulent de nos jours – cela n’a pas été le cas
chaque fois dans ses romans, puisque Michel Ragon puise aussi ses indignations
dans l’Histoire –, au cœur d’un monde paysan en butte à une restructuration
aussi profonde et traumatisante que celle du monde industriel.
Tout commence avec un remembrement, c’est-à-dire une
réorganisation des terres, qui démembrait en réalité tout ce que le père de
Louis, et son grand-père, et ses aïeux qu’il n’avait pas connus, avaient mis
des siècles de patience à réaliser : une terre d’un seul tenant autour d’une
maison, de son étable et de sa grange. Ce n’est que le premier coup. Une
expropriation suit bientôt, pour élargir un chemin. Dans la foulée, un premier
mouvement de révolte s’organise en solidarité avec Louis : les paysans
vont déverser du purin dans la cour de la sous-préfecture. « C’était leur
nouvelle manière de chouanner. »
Dès lors, la situation ne va cesser de se transformer, dans
le sens d’une rationalisation de l’agriculture et de l’élevage. La
modernisation, réputée indispensable, bouleverse de fond en comble les
habitudes des paysans, sous la double pression des techniques enseignées aux
jeunes et des exigences européennes. Les premières déconcertent les anciens, les
secondes les mettent en colère. Celle-ci génère des conflits avec les autorités,
une grande manifestation nationale à Paris… Le roman s’inscrit dans une réalité
dont les journaux ont largement rendu compte au fur et à mesure qu’elle s’installait.
La fiction a souvent le pouvoir d’éclairer la surface des
choses mieux que ne le fait une relation des événements au jour le jour, parce
qu’un récit offre une vision globale et bénéficie du recul nécessaire à une
compréhension plus complète. D’où vient alors que ce roman de Michel Ragon, à
la différence de la plus grande partie de son œuvre, laisse un goût d’inachevé ?
Il semble que l’auteur ait voulu trop bien faire, exposer thèses et antithèses
dans des conversations entre personnages, dans des mises en situation trop
simples pour être tout à fait crédibles.
On lit donc Les
coquelicots sont revenus sans déplaisir mais aussi sans enthousiasme, comme
une démonstration un peu pesante. Michel Ragon, pour une fois, n’a pas vraiment
atteint son but, qui consistait vraisemblablement à nous faire entrer, de l’intérieur,
dans un monde singulier. On reste donc au bord de celui-ci, en spectateur qui
ne sait toujours pas comment il pourrait être partie prenante dans un débat qui,
cependant, le concerne, qu’il le veuille ou non.
Un si bel espoir (1999)
Michel Ragon, anarchiste socialiste, comme il aime à se
définir lui-même, est aussi, entre autres choses, historien de l’architecture. Quand
il vient chez nous, il ne répugne pas à rappeler que c’est chez un éditeur
belge, Casterman, qu’il a publié dans les années septante son Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme
modernes en trois volumes. Mais, depuis une quinzaine d’années et Les mouchoirs rouges de Cholet, il est
surtout connu comme romancier (il avait, ceci dit, publié déjà huit romans
auparavant). Un romancier qui ne renie cependant rien de ses passions quand il
se met à inventer des histoires. Celle-ci, Un
si bel espoir, met en scène un architecte utopiste, Hector, de 1848 aux
années 1870, dans une époque propice à bien des révolutions sociales, techniques
et artistiques.
De cette époque, précisément, dans ses différents aspects, Michel
Ragon nous trace un portrait qui vaut bien, pour sa connaissance, plusieurs
ouvrages historiques. Ses personnages, en effet, Hector et les autres, traversent
plusieurs milieux différents qui sont donc chaque fois vus de l’intérieur, dans
leur fonctionnement propre.
Le monde artistique est bien sûr privilégié. Ambroise, l’ami
d’Hector qui sera longtemps son associé, et qui a plus que lui les pieds sur
terre, monte en sa compagnie quelques projets grandioses dont la plupart
échoueront tout en étant pillés par d’autres architectes. Les plus
spectaculaires sont le Crystal Palace de Londres et les Halles de Paris – Il
faut imaginer un ventre, un énorme ventre, dit Courbet dans un bel anachronisme
en forme de clin d’œil.
Courbet, profitons de l’apparition de son nom, joue un rôle
essentiel dans le roman. Parce que, comme Hector dont il est l’ami et avec qui
il partagera, à peu de choses près, une femme, le peintre refuse les
concessions, soucieux de suivre sa propre voie malgré les refus que lui
opposent les milieux de l’art officiel. Au passage, on se trouvera à l’origine
de L’origine du monde : « Quel
choc ! Quelle émotion ! Pouvait-on parler de nu, de nudité, devant ce
rectangle qui sectionnait un corps, du ventre au haut des cuisses, mettant en
valeur, en seule valeur, le sexe, la toison pubienne peu épaisse, brune, avec
des reflets roux, la fente aux lèvres légèrement écartées, qu’une tache rouge, au
creux de la fissure, illumine ? »
Tout aussi radical dans ses options architecturales, Hector
s’éloigne peu à peu d’Ambroise prêt à quelques compromissions avec le pouvoir
pour faire reconnaître son talent et son savoir-faire par Haussmann et Morny, les
personnages sans lesquels rien ne se décide. L’extraordinaire déperdition d’énergie
constituée par le travail souvent vain d’Hector désole Ambroise qui aimerait
lui faire partager un peu de son réalisme et de son succès. Pourtant, Hector
dévient célèbre, mais grâce surtout à un Panorama
de l’Égypte antique, les souvenirs illustrés qu’il a rapportés d’un séjour
destiné à travailler sur le chantier du canal de Suez. Bien sûr, sur place, ses
centres d’intérêt se sont révélés peu compatibles avec les côtés pratiques de l’entreprise.
Hector est un incorrigible rêveur toujours mené par l’idée
qu’on finira bien par reconnaître les mérites de ses projets. Toute son énergie,
toute son imagination, furent de nouveau consacrées à concevoir des œuvres que
personne ne lui demandait et qu’il présentait avec une telle insistance, une
telle certitude d’être dans la vérité, qu’elles importunaient les services
publics qui les rejetaient brutalement.
Côté plus politique, ou idéologique, Proudhon est au premier
rang des penseurs admirés par Hector. Ce n’est pas une surprise. Proudhon qui
se trompe toujours sur les détails, jamais dans la pensée philosophique, et qu’Hector
va voir lors de son exil bruxellois, pour le retrouver avec joie à Paris en
1862, lorsque Napoléon III amnistie les crimes politiques. Puis d’apprendre,
avec douleur, sa mort au début de 1865. Dans la foulée, Morny, son exact opposé,
meurt aussi. Et Julie, la maîtresse tant aimée, qui si souvent a trahi Hector, dont
la présence donne à la part privée du livre un souffle romanesque puissant…
L’Empire, qui défie la Prusse, se craquèle. C’est bientôt la
Commune avec l’avènement de laquelle Hector voit enfin arriver son heure de
gloire, ses idées reconnues et adoptées. Mais l’histoire balaie toujours trop
vite devant elle, et c’est en déportation, en Nouvelle-Calédonie, que s’achève
le parcours.
Un parcours d’un romantisme échevelé, qu’on a suivi en
partageant l’enthousiasme de son acteur principal, tant il est vrai que la
puissance d’un idéal profondément enraciné est toujours plus forte, aux yeux du
lecteur, que la stérilité – d’ailleurs souvent provisoire – de tous les efforts
déployés pour mettre cet idéal en pratique.
Un rossignol chantait (2001)
Michel Ragon remonte les années, pas plus loin que son
enfance et reprend des souvenirs placés à l’ombre des grands-parents et du
château où ils avaient travaillé, déchus de leur gloire par procuration quand
ils l’avaient quitté, méprisés par les habitants du village. La pauvreté donne
peut-être de l’imagination. Assez pour rêver d’une voix de petite fille ou pour
espérer un jour une vie différente. En attendant, l’enfant s’emplit la mémoire
d’images simples. Le conteur sait l’art de gommer le temps et de nous donner
les clefs de ses souvenirs.
Le prisonnier (2007)
Un écrivain reçoit les lettres d’un prisonnier. Celui-ci
confond un personnage de roman et Christine. Qui fut l’épouse de l’écrivain. Le
prisonnier l’a connue. Sous un jour très différent. Intrigué, irrité, le
narrateur balance entre l’envie d’en savoir plus et celle d’interrompre le
dialogue. Il s’interroge surtout sur lui-même : des origines modestes et
un statut social enviable. Le cul entre deux chaises, mal à l’aise partout. Sous
l’anecdote, de vraies questions.