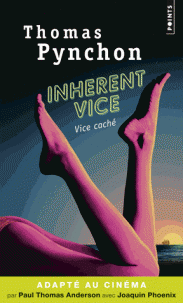|
| Photo Seamus Kearney |
La littérature et le continent africain viennent de perdre, apprend-on dans la même journée, deux figures majeures: l'Algérienne Assia Djebar, qui était entrée à l'Académie française en 2005, et le Sud-Africain André Brink, lauréat du Prix Médicis étranger en 1980. Elle était née en 1936 et lui, en 1935. Ils étaient donc d'exacts contemporains mais je ne vais malheureusement pas leur réserver le même traitement, car j'ai peu fréquenté, hasard des lectures, l'oeuvre d'Assia Djebar, au contraire de celle d'André Brink dans laquelle voici quelques étapes, parmi les dernières - les dates fournies étant celles des traductions en français - d'un parcours littéraire fortement marqué par l'époque de l'apartheid.
Un acte de terreur (1992)
Quel est l'enjeu ? André Brink multiplie les points de
vue. Et, sur ce point précis, donne deux réponses. Celle de Rashid, un des
membres d'un groupe terroriste qui a essayé d'assassiner le président : « Au fond, je sais que ce n'est pas les
Blancs contre les Noirs, c'est les nantis contre les pauvres. C'est classe
contre classe. » Et celle d'une femme, Lisa : « J'en suis arrivée à penser que
c'était le vrai problème. Pas les Noirs et les Blancs, mais les hommes. Ce sont
eux qui ont le pouvoir. »
Alors ? Où est la vérité ? Mais y a-t-il seulement
une vérité simple ou bien est-on condamné à entendre toutes ces voix sans
décider laquelle a raison?
André Brink, en tout cas, nous aide davantage à nous poser
des questions qu'à trouver des réponses, ce qui est somme toute la vocation de
la littérature. Thomas Landman, le personnage principal de son roman, n'est pas
un personnage simple. Photographe choqué par la violence contre les Noirs, il a
témoigné par son travail et s'est trouvé, petit à petit, convaincu qu'il n'y
avait pas d'autre moyen que la violence pour répondre au pouvoir. Avec Nina,
son amante et sa sœur de combat, il a, à l'intérieur d'un groupe très organisé,
mis au point un attentat contre le président d'Afrique du Sud. L'attentat a
échoué, Nina a été abattue peu de temps après, et Thomas est en fuite. Lisa,
embarquée là-dedans sans donner l'impression de très bien savoir où elle se
trouve – mais elle fera preuve d'un courage et d'une présence d'esprit peu
communs –, l'accompagne dans la deuxième partie (le deuxième volume) du roman,
mais elle n'est pas à la place de Nina, elle est elle-même, avec sa
personnalité et sa force, étonnante, rayonnante.
On ne résume pas ces 1 200 pages en quelques
lignes, d'autant qu'elles touchent à plusieurs genres différents. Un acte de terreur est un thriller
brillamment construit, une chasse à l'homme qu'on suit à en perdre haleine.
C'est aussi la conséquence d'une histoire vieille de treize générations – et
cette histoire, racontée par Thomas, occupe la fin du livre, comme un
nécessaire arrière-plan explicatif. C'est encore l'illumination de grands – et
brefs – moments de bonheur dans ce que vivent Thomas et Nina d'une part, Thomas
et Lisa d'autre part. C'est surtout un ensemble d'événements qui se déroulent à
plusieurs époques, dans des cadres différents, tous ces éléments mis sur le
même plan, et pourtant on ne s'y perd jamais tant les choses sont claires.
C'est, tout compte fait, comment le dire autrement ?,
un grand roman.
Les imaginations du sable (1996)
André Brink aime les romans amples, qui brassent beaucoup de
personnages et laissent se dérouler leur histoire sur un nombre de pages
considérable. Les imaginations du sable
ne sont pas, de ce point de vue, inattendus : c'est un gros livre dans
lequel se succèdent neuf générations de femmes, du dix-huitième siècle à nos
jours, sur une terre d'Afrique du Sud en proie aux soubresauts de l'histoire. « Nos
jours » se situent très exactement en avril 1994, au moment des premières
élections multiraciales dont l'ANC est sorti vainqueur.
Abandonner un régime d'apartheid n'a pas été facile, tout le
monde s'en souvient sans doute, et le roman se déroule à deux vitesses. La
première, en quelques jours, rend compte du climat régnant dans le pays – dans
une partie du pays – à la veille de ces élections. La deuxième, dans le même
temps, remonte vers le passé par le récit qu'en fait une grand-mère à sa
petite-fille.
Kristien, la jeune femme, a quitté le pays sans espoir de
retour, onze ans avant, écœurée par l'injustice d'une structure sociale basée
sur le pouvoir blanc. Elle est cependant blanche elle-même, mais animée
d'idéaux qui l'opposent à sa famille, à ses proches – à l'exception d'Ouma, la
grand-mère qui comprend tout. Kristien a vécu à Londres jusqu'au moment où un coup
de téléphone de sa sœur Anna l'a poussée dans l'avion, sans réfléchir, parce
qu'elle avait le sentiment de ne pas pouvoir faire autrement : Ouma était
mourante, à plus de cent ans, partiellement brûlée dans l'incendie criminel de
sa maison, une construction folle de laquelle les enfants, dans leurs
explorations, n'avaient pas épuisé les secrets.
De retour, donc, Kristien redécouvre un monde qui a peu
changé, même s'il s'apprête à vivre un immense bouleversement. Le mari d'Anna
est le prototype du Blanc campé sur les positions de son bon droit ancestral,
devenu d'autant plus agressif qu'il entrevoit des lendemains moins
réjouissants. Ce personnage déplaisant n'est pas seulement un Blanc : il
est aussi un homme, qui règne sans partage chez lui, qui considère Kristien
comme une femme à prendre, et peu importe qu'elle soit sa belle-sœur, bref, qui
affirme son pouvoir à chaque instant.
On comprend très vite que Les imaginations du sable superposent à une première opposition,
Blanc/Noir, une seconde non moins signifiante, homme/femme. On le comprend
d'autant mieux à travers les histoires qu'Ouma raconte à Kristien dont elle
veut faire la dépositaire d'une longue mémoire. Ouma dira à peu près, lors
d'une de ces nuits où elle murmure son récit sur son lit de mort : un
homme sait ce qu'il met dans le ventre d'une femme, il ne sait pas ce qui en
sort. Et la tradition familiale n'est pas là pour démentir cette vérité. Neuf
générations de femmes révoltées ont en effet construit leur propre existence,
malgré les hommes, malgré les circonstances, en fonction de ce qu'elles
voulaient. Ainsi, même la mère de Kristien, Louisa, aurait eu une vie secrète
rapportée dans des journaux intimes – qui ont disparu dans l'incendie.
Le conditionnel s'impose, à tel point que Kristien, une
fois, reprochera à Ouma de ne pas lui dire la vérité mais d'en inventer une
version légendaire. Qu'importe, répond en substance la grand-mère, ce que je
veux te raconter, ce sont des histoires…
Elles sont magnifiques, ces histoires, héroïques, symboliques.
Elles paraissent couler d'une source inépuisable qui se tarira cependant à la
fin du livre – un livre qu'on quitte alors à regret, mais plus lourd, plus
riche de tout ce qui nous a été raconté.
André Brink a écrit ici une grande saga de tous les temps et
d'aujourd'hui, avec une audace rare, et avec une capacité, encore plus rare, à
se fondre dans des voix de femmes. Faut-il rappeler, pour finir, qu'André
Brink, sud-africain lui-même, est un de ces écrivains blancs qui ont participé
à l'évolution des mentalités dans son pays ?
L’amour et l’oubli et L’insecte
missionnaire (2006)
L'écrivain sud-africain se livre probablement beaucoup dans L'amour
et l'oubli, une vaste rétrospective – romanesque, il faut quand même le
souligner – des femmes qu'un écrivain a aimées.
L'écrivain s'appelle Chris Minnaar, son parcours est
différent de celui d'André Brink, mais il y a entre les deux vies assez de
points d'intersection pour que cela ressemble à une autobiographie, sur un plan
au moins : l'engagement personnel contre l'apartheid. Pour ce qui est de
la vie amoureuse d'André Brink, après tout, quelle importance ?
Celle de Chris Minnaar, en revanche, nous concerne au
premier chef. Nous l'accompagnons pendant près de 500 pages avec
l'impression de recevoir ces confidences en cadeau. Elles viennent d'un homme
qui vient de voir mourir Rachel, dont il est certain qu'elle restera sa
dernière femme. Rachel a été sauvagement agressée – l'Afrique du Sud d'après
l'apartheid n'est pas devenue un paradis, le romancier fait bien de nous le
rappeler – et est entrée dans un profond coma. Chris ne l'avouera qu'à la toute
fin du livre : il a été à deux doigts de commettre un geste définitif pour
abréger les souffrances de Rachel.
Le jour même de la mort de sa maîtresse, Chris entreprend de
lui rendre hommage – à elle et aux autres. « Et c'est pourquoi j'aime
mes femmes et chacune d'entre elles : chacune a été adorée, chacune a été
nécessaire. J'ai toujours été bien présent, pleinement là, dans le lit de
l'amour, aimant la réalité d'un corps précis, chaque particularité, chaque
détail, chaque palpitant signe de vie. »
Le récit commence dès l'enfance, dans un milieu rigoriste où
les secrets du sexe ne sont pas dévoilés. Mais se donnent à connaître par
hasard. Il pourrait, au fil du temps, se transformer en catalogue de conquêtes.
Il ne tombe jamais dans ce travers épuisant. Toujours l'exaltation des sens est
au rendez-vous, qui aiguillonne l'esprit et lui donne une plus grande vivacité.
Elle lui fournit aussi les premières occasions de transgression :
l'Immorality Act, qui interdit les rapports sexuels entre races différentes,
est allégrement bafoué par Chris à tout âge – et il découvrira que son père, un
parangon de vertu, avait cédé lui aussi à la tentation.
Toutes ces femmes, en Afrique du Sud, à Londres ou à Paris,
ont constitué l'homme qu'il est devenu.
Et ce sont elles encore, resurgissant en foule de sa
mémoire, qui lui permettent de rompre avec le syndrome de la page blanche dont
il souffrait depuis plusieurs années.
Pendant le temps où Chris rédige ce texte, la guerre d'Irak
fait rage, qu'il suit la nuit à la télévision comme un spectacle dont les
enjeux lui paraissent bien obscurs. A la fin de l'ouvrage, la guerre se
termine, le laissant avec une sensation de vide, et sa mère meurt.
Si l'on veut extraire une réflexion qui, pour celle-là au
moins, appartient autant au personnage qu'à André Brink, ce sera celle-ci : « L'Afrique
du Sud était devenue la seule femme que je ne pourrais jamais, en fin de
compte, quitter, parce qu'elle-même refusait de me quitter. Jusqu'à ce que la
mort nous sépare. »
L'autre roman, traduit simultanément, est très différent. L'insecte
missionnaire renoue avec les explorations personnelles que fait
l'écrivain dans le passé de son pays. Le titre renvoie au patronyme du
personnage principal, Cupido Cancrelas. Qui, bien que hottentot, devint
missionnaire au début du XIXe siècle. Drôle de bonhomme, ce Cupido. Très
vite, il veut apprendre à lire, avec l'aide des filles du baas, qui pique une
belle colère : « Qu'est-ce qu'un hottentot pourrait bien faire de
savoir lire et écrire ?, s'insurge-t-il. C'est courtiser
le danger. Un de ces jours, il va se prendre pour un Blanc. Il ne saura plus où
il en est. »
Le baas se trompe : jamais Cupido ne se prendra pour un
Blanc. Si cela avait été le cas, son épouse se serait chargée de lui rappeler
qu'il est bien un Noir, au moment où, installé à Dithakong pour sa mission
d'évangélisation, il ne reçoit aucun soutien de sa hiérarchie. Si bien que la
congrégation qu'il avait fondée dans l'enthousiasme se désagrège petit à petit,
jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui, seul. Qui écrit, après beaucoup
d'autres, une dernière lettre à Dieu : « Tout ce que je peux
encore faire, c'est prêcher. Je prêche pour les Pierres, les Buissons, le
Lézard sur son Rocher, le Serpent et les Tortues dans la poussière, et je peux
prêcher même à la Poussière et à la Mante religieuse verte, qui est rare dans
cet endroit. Mais dans quel but ? Est-ce qu'un Arbre ou une Pierre ou une
Sauterelle peut se convertir ? »
C'est l'échec du missionnaire. Mais pas celui de l'insecte :
dans un ultime chapitre d'une beauté foudroyante, André Brink retourne les
données pour en faire les bases d'un nouveau départ.
Mes bifurcations (2010)
Les Mémoires d’André Brink sont un ouvrage
capital. Pour comprendre le cheminement esthétique d’un immense écrivain. Pour
comprendre aussi l’évolution d’un homme que rien ne prédestinait à devenir,
dans son Afrique du Sud natale, un opposant à l’apartheid. Les deux aspects
sont liés. En revenant sur le passé, Brink montre les nœuds qui l’ont conduit
aux Bifurcations à l’enseigne desquelles il place ce livre. « Rien
n’est jamais vraiment éliminé. Les choix éliminés continuent d’exister aussi
sûrement que ceux, rares, dont on peut dire qu’ils ont été “retenus” – de même
que le non-dit persiste dans ce qui est exprimé. Il est fort possible que ce
soit cette coexistence qui, finalement (pour autant qu’il y ait une fin),
définisse la texture d’une vie. »
Sa jeunesse se déroule en noir et blanc, surtout côté blanc
d’ailleurs, sans interrogations majeures sur l’injustice d’une société qui
privilégie la minorité au pouvoir. Son père, juge, lui donne à la fois
l’exemple d’une haute idée du bien et du mal, et celui d’un incompréhensible
détachement devant certaines scènes choquantes. André veut être écrivain – mais
sa sœur, de trois ans sa cadette, publie avant lui et connaîtra le succès comme
auteur pour la jeunesse. Dans le bouillonnement de ses lectures et de ses
premières tentatives romanesques, des échecs qui ne remettent pas sa vocation
en cause, un choc salutaire se produit en Europe. En 1960, il est à Paris quand
il apprend le massacre de Sharpeville, au cours duquel des dizaines de Noirs
ont été tués par la police. La même année, à Londres, il découvre Picasso dont
l’art libère en lui « une profusion de possibilités »,
dans le même temps où il prend conscience de la violence du régime : « Les
assassins étaient mes semblables ; le régime qui avait non
seulement rendu cela possible mais l’avait orchestré activement et avec
enthousiasme était ce même gouvernement auquel, à peine quelques mois plus tôt,
j’avais avec empressement juré allégeance en adhérant au Ruiterwag. » Le
Ruiterwag, où il côtoyait F.W. De Klerk, futur président, la branche cadette du
Broederbond, l’organisation secrète afrikaner…
La perspective change. André Brink devient, avec d’autres,
un écrivain en colère pour qui les mots sont des armes. La résistance à
l’apartheid s’organise sur divers plans, force subversive que le gouvernement
veut réprimer, mettant notamment la censure en place. « Mais, dans
ce silence oppressant, il restait une voix qu’on pouvait encore entendre, même
si elle était diabolisée ou devenue suspecte pour un grand nombre : la
voix de l’art. Dans mon cas, la voix romanesque. »
Elle l’a conduit où l’on sait : Au plus noir de la
nuit, Une saison blanche et sèche, L’insecte
missionnaire… Une œuvre imbriquée avec les soubresauts de sa vie, y compris
sentimentale, et indissociable du dernier demi-siècle en Afrique du Sud.
« Dans ce processus, je suis devenu, et c’est
irrévocable, un animal politique. Désormais, il serait hypocrite de ma part
d’imaginer que la politique puisse rester un territoire distinct, nettement
démarqué à l’intérieur de mon expérience globale de l’existence. Elle est
partout, imprègne tout. On ne peut la séparer du reste. »
Dans Mes bifurcations, André Brink rend hommage
à deux hommes qui l’ont particulièrement marqué : Desmond Tutu et Nelson
Mandela. Mais il s’élève avec force contre ce que devient le pays auquel les
années nonante avaient rendu l’espoir. « En Afrique du Sud,
l’immémoriale tension raciale continue donc de paralyser le débat
démocratique », écrit-il en dénonçant les dérives de l’ANC où il voit
la réplique du passé.
Euphorie, réalisme, désillusion, rancœur, désespoir… « Il
nous reste à accomplir le possible », disait-il déjà il y a quelques
années. Tout un programme.
Philida (2014)
Le 1er décembre 1833, les esclaves d’Afrique du
Sud deviennent libres, comme dans tout l’Empire britannique. Parmi eux,
Philida, une jeune femme dont la spécialité officielle, avant cette date, est
le tricot. Et la principale caractéristique, moins avouable, d’avoir eu quatre
enfants, dont deux sont vivants, avec Frans Brink, le fils de son baas. Ils ont grandi ensemble, ils sont
victimes d’une attirance réciproque inévitable autant qu’inacceptable. Philida,
humiliée publiquement, vendue, efface l’amour de sa mémoire et va de l’avant.
Frans est rongé par le remords de n’avoir pas résisté à l’autorité de son père,
tente de reconquérir la femme qu’il n’a pas oubliée mais finira par subir la
contrainte d’un mariage qui peut sauver les siens de la ruine.
On aura noté que la famille à laquelle appartient Philida –
un esclave est un bien meuble – s’appelle Brink. L’écrivain, dans ses
remerciements, explique que Cornelis Brink, le père de Frans, était le frère
d’un de ses ancêtres. Il précise ce qui est authentique dans son livre :
tout ce qui était vérifiable, soit beaucoup de choses, le reste étant construit
comme une fiction vraisemblable.
Et une fiction comme André Brink sait les mener,
c’est-à-dire avec la profondeur de champ qui place les personnages dans le
contexte. Avec, aussi, une manière élégante de dévoiler la vérité et la
complexité de chacun. Rien n’est vraiment expliqué mais tout est montré, au
lecteur d’assembler les morceaux, ce qu’il fait sans difficulté tant les
éléments de compréhension sont en place. Par ailleurs, il faut attendre les
dernières pages pour prendre la mesure de l’énorme documentation accumulée pour
l’écriture de Philida. Car, dans le
cours du récit, elle ne le surplombe ni ne l’étouffe jamais, si bien qu’on y
baigne sans le savoir. Mais avec la vive impression d’être au cœur du réel. Un
réel bientôt vieux de deux siècles et revisité comme si nous étions ses
contemporains.