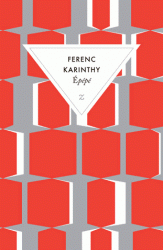Les quelques semaines d'actualité Marcel Proust que je vous fais revivre ici à travers les articles analysant Du côté de chez Swann se termineront mercredi - avec un texte capital pour l'avenir du livre et de sa suite. Aujourd'hui (enfin, aujourd'hui il y a cent ans), c'est L'Intransigeant qui réserve bon accueil au premier roman de l'auteur.
« Du côté de chez Swann »
Une « manière » nouvelle
On parle beaucoup du livre de M. Marcel Proust[1].
On pourra en parler longtemps encore et en dire des choses très diverses. Car,
à proprement parler, ce n’est pas un seul livre, mais trois livres très
différents de ton, sur de mêmes personnages, en un seul volume. D’autres
volumes suivront ; Du côté de chez
Swann n’est encore qu’une partie de À
la recherche du temps perdu.
Cela explique que l’exposition psychologique du « côté de chez
Swann » prenne deux cent vingt-neuf pages. C’est en effet l’exposition
d’un ensemble. Dans ces pages, l’auteur présente les lieux et les gens. Le lieu
central est Combray, autour de quoi il y a pour les promenades deux côtés
opposés : le côté de Méséglise qu’on appelle aussi le côté de chez Swann
parce qu’on passe devant la propriété de M. Swann pour aller par là, et le
côté de Guermantes.
Sur ces côtés et les êtres qui les habitent, M. Proust dit tout ce
qu’il y a à dire. Il n’écrit pas pour les gens qui lisent en autobus et n’ont
pas de temps pour savourer un ouvrage. Quand il a une explication à donner, il
ne voit aucune raison de se priver de la développer. Il le fait toujours d’une
façon originale et minutieusement précise. Ses descriptions de caractères
participent des derniers progrès de la psychologie expérimentale et pourraient
servir d’exemples aux remarques de Matière
et Mémoire, de Bergson. Cette assimilation est nouvelle dans le roman.
Ainsi, on trouvera quatre pages où est expliqué, avec une sincérité
profonde, pourquoi et comment une bouchée de madeleine peut évoquer par
associations d’idées un souvenir d’enfance. Ainsi, quatre autres pages
clairvoyantes analysent la dualité qui s’établit dans l’âme de l’homme qui lit
et est à la fois lui-même et les personnages d’un livre. Ainsi encore les pages
où M. Proust fait agir les deux personnages que crée chez un interlocuteur
cette simple question : « Est-ce que vous connaissez, monsieur, les
châtelaines de Guermantes ? »
Cette habitude de l’analyse psychologique procure à l’auteur des remarques
qui sont formulées de la façon la plus heureuse. Par exemple, lorsque, après
une longue promenade, on revoit la porte de sa maison :
Et, à partir de cet instant, je
n’avais plus un seul pas à faire, le sol marchait pour moi dans ce jardin où
depuis si longtemps mes actes avaient cessé d’être accompagnés d’attention
volontaire : l’Habitude venait de me prendre dans ses bras et me portait
jusqu’à mon lit comme un petit enfant.
Voici encore une remarque fine :
Les torrents de larmes qu’elle
versait en lisant le journal sur les infortunes des inconnus se tarissaient
vite si elle pouvait se représenter la personne qui en était l’objet d’une
façon un peu précise.
Et ceci, sur la façon dont on aime à vingt ans et à quarante :
Autrefois, on rêvait de posséder le
cœur de la femme dont on était amoureux ; plus tard, sentir qu’on possède
le cœur d’une femme peut suffire à vous en rendre amoureux.
Ces exemples n’étaient-ils pas nécessaires pour faire comprendre la manière
de M. Marcel Proust ?
*
Ou plutôt : la manière de la première partie du premier volume de
M. Marcel Proust. Car ensuite, le ton change. Nous allons assister à la
vie d’un amour, un véritable roman commence. Nous tombons dans le salon, à
peine caricatural, des Verdurin. Nous y voyons un blasé israélite, Swann,
tomber amoureux fou, comme le pire collégien naïf, d’une cocotte, Odette. Le
roman est amusant, paradoxal et minutieux. L’écrivain Du côté de chez Swann y prouve qu’il a la manière de juger les
petites choses, cette manière qui distingue certains esprits, aristocrates avec
naturel, et les rend incapables de s’empêcher de remarquer que les gants d’une
dame sont allés chez le teinturier.
M. Proust fait agir et souffrir ses personnages avec une sensibilité
de tortionnaire ; et c’est ainsi que Swann, épuisé de douleur, arrive au
bout de son amour, guéri.
*
Aussi sommes-nous bien étonnés de voir, à la troisième partie du livre, une
petite Gilberte Swann jouer aux Champs-Elysées. À la fin nous apprenons que
Swann a épousé Odette.
Notre voyage du Côté de chez Swann
se termine par une jolie évocation de l’avenue des Acacias à la fin du siècle
dernier. Et c’est encore là un des visages de M. Proust. Il se montre
« vieux Parisien » ; quel charme mélancolique pour nous
d’entendre un de ses personnages dire : « Ce soir, nous irons voir
jouer Coquelin ».
Certes, on pourrait parler longtemps encore d’un écrivain aussi divers que
M. Marcel Proust. Si on relit son livre, on y découvre encore de nouveaux
aspects, on y trouve l’amusant spectacle que donne un kaléidoscope. À cette
page, c’est la fraîche et émue description d’un clocher, un délicieux paysage
d’enfance ; à cette autre nous voici auprès de curieuses gens de province ;
ici, une fine ironie attendrie pareille à celle que peut éprouver un
entomologiste sous l’œil duquel un insecte s’agite ; là, une phrase de
douleur, un homme malheureux qui palpite. De tout cela est composé le livre,
comme de pierres précieuses, de coquillages, de fleurs brisées, de scalpels, de
microscopes et de cœurs vivants pourrait l’être une inimitable pyramide.
L’Habit Vert.
[1] À la recherché du temps perdu, Du
côté de Chez Swann, par Marcel
Proust (Bernard Grasset, éditeur).