Vous êtes écrivain. C'est une supposition. Toute considération économique mise à part, quel prix littéraire préféreriez-vous recevoir ? Nobel ou Kafka ? Inventeur de la dynamite ou auteur de La métamorphose ? Si vous avez répondu : Nobel, c'est perdu. Si vous avez répondu : Kafka, vous êtes espagnol, vous vous appelez Eduardo Mendoza, et vous êtes le plus heureux des hommes puisque votre oeuvre, commencée en 1975 avec La vérité sur l'affaire Savolta et forte aujourd'hui d'une quinzaine de romans, traduite partout, vient d'être couronnée, à Prague, par le Prix Franz Kafka. Vous vous rendrez gaiement en République tchèque, fin octobre, pour le recevoir, sans craindre d'être transformé en cloporte.
Et puis, tiens, comme on est content pour vous, on va s'arrêter sur trois de vos livres.
L’île enchantée
(1992)
Fabregas, le héros de L’île enchantée, pourrait
être un cousin de Gregorio, personnage principal du premier roman de Luis
Landero. « Rêver. Au fond, toute ma
vie, je n’ai su faire que ça : rêver, songea Fabregas un matin de
printemps. » Lui ne se berce pas seulement de mots. Il a la chance de
diriger une société, héritée de son père, dont la solidité n’est pas à toute
épreuve mais qui marche encore assez bien pour lui procurer de quoi vivre
tranquillement sans s’inquiéter du lendemain. Sa vie lui pèse, il la fuit. À
Paris, d’abord, puis à Venise où il arrive un soir de la mi-avril – ce début
est expédié en deux pages par Eduardo Mendoza. Un coup de cœur étreignit
Fabregas : « S’il doit m’arriver
quelque chose d’important, pensa-t-il, c’est ici ou nulle part. »
Les aventures qui vont être les
siennes ne sont pas vraiment extraordinaires, mais elles le sortent de son
ordinaire, et il s’en trouve plutôt bien. Il rencontre une jeune femme qui
devient son guide dans Venise, cet archipel d’îles aussi mystérieuses qu’enchantées.
Il est, bien sûr, amoureux d’elle et ne comprend pas toujours son attitude qu’il
interprète le plus souvent de travers. L’essentiel est aussi que, dépouillé de
ses habitudes d’homme d’affaires, Fabregas devient enfin lui-même, au bout de
son rêve, et même si ce rêve est parfois cauchemar. Il a trouvé sa vérité.
L’année du déluge
(1993)
Il ne suffit pas d’aimer mettre
en scène des personnages au bord du gouffre. Encore faut-il leur donner vie de
manière à ce qu’on croie non seulement à leur tentation de basculer mais
davantage encore à ce qui constituait leur réalité l’instant d’avant, quand
rien ne laissait présager qu’ils pourraient, sur un mot, sur un geste, modifier
leur destin. Faire mine de bâtir un avenir sur du roc pour mieux découvrir
ensuite la faille qui, inexorablement, va détruire ce roc et tout ce qui
reposait sur lui…
Eduardo Mendoza ne fait rien d’autre,
mais il le fait avec talent, dans L’année
du déluge dont le titre paraît non seulement dater l’action mais aussi
fixer l’attention sur une caractéristique principale : c’était du temps où
les eaux du ciel firent déborder les rivières en Catalogne et transformèrent
les routes en torrents. Certes, c’est bien cette année-là, ainsi repérée dans l’écoulement
du temps par ceux qui la vécurent. Mais le contexte est un trompe-l’œil et c’est
de débordements bien différents qu’il est question en réalité ici.
Sœur Consuelo dirige, à San
Ubaldo, un hôpital déglingué qu’elle voudrait, à l’occasion de la construction
d’un nouvel établissement de soins à proximité, transformer en asile de
vieillards. La nécessité d’un tel lieu se fait de plus en plus sentir à une
époque où les familles ne gardent plus les ancêtres jusqu’à leur mort, et il y
a dans ce projet quelque chose qui correspond bien à la charité chrétienne
telle que l’entend sœur Consuelo.
Logiquement, celle-ci s’adresse
au propriétaire le plus fortuné de la localité pour obtenir les premiers fonds
après lesquels, croit-elle, les subsides officiels ne pourront que suivre
naturellement. Mais elle ne connaissait pas Augusto Aixela de Collbato, et
moins encore sa réputation de séducteur, aussi excité à l’idée de faire tomber
une nouvelle proie dans son lit que pressé de s’en détourner ensuite. D’autant
plus fragile qu’elle est inexpérimentée en la matière, sœur Consuelo ne
manquera pas de s’engouffrer, tête baissée, mais l’âme blessée, dans le piège
tendu.
La précarité des bonnes
résolutions pourrait être le thème principal de ce roman bref, mais Eduardo
Mendoza, malgré la gravité du sujet, est loin de s’en contenter. Il met en
scène des univers différents et complémentaires. Outre le couvent et la
propriété du riche terrien, on trouve encore dans son livre des bandits dont la
figure principale, qui amènera sœur Consuelo devant le peloton d’exécution, a
tout d’un romantisme bien propre à toucher, une fois encore, un cœur sensible.
Décidément, entre les inondations
qui ravagent non seulement la région mais aussi l’hôpital, les enquêtes de la
police, les attraits du riche propriétaire, les soupçons de l’économe du
couvent, la volonté de transformer les lieux, les rêves et la réalité, sœur
Consuelo a vraiment beaucoup à faire et on ne s’étonne pas qu’elle ne fasse pas
toujours la part des choses entre le chemin qu’elle veut suivre et celui qu’on
voudrait lui faire suivre.
Ce n’est, somme toute, qu’une
histoire d’amour déçu. Mais Eduardo Mendoza lui donne, dans le contexte qu’il
fait sien, la profondeur d’un étang sombre dans lequel la tentation est grande
de se noyer pour tout oublier. C’est que les problèmes sont parfois trop aigus
pour autoriser encore la sérénité ensuite. Le destin de sœur Consuelo, cependant,
aura encore bien d’autres chemins à emprunter et nous pourrons l’accompagner
jusqu’au bout de cette route qui fut si pentue et si tortueuse. Est-ce cela, le
chemin de la rédemption ? Qu’on y croie ou pas, on a envie, en tout cas, d’être
le propriétaire du bras qui fera faire à sœur Consuelo sa dernière promenade
sur le terrain de ses déceptions, mais aussi de ses plus grands moments de joie.
Qu’est-ce qui aura été, pour elle, le sommet du bonheur ? Des moments
volés à son amour de Dieu ou, au contraire, l’accomplissement de ses vœux ?
Faut-il vraiment répondre ?
Pomponius Flatus est
philosophe et naturaliste. Romain, comme tous les lecteurs d’Astérix l’auront
deviné. Dans les premières années de l’ère chrétienne, il échoue en Palestine
un peu par hasard, après avoir cherché en vain dans les environs une eau qui procure
la sagesse à celui qui en boit. Il est malade. Peut-être son nom le
prédispose-t-il aux flatulences, sonores et nauséabondes, accompagnées de
diarrhées qui le font atrocement souffrir. Il faudrait un miracle…
Coup de chance : il est à
Nazareth où grandit le jeune Jésus, inconscient encore de son destin. Comme un
Harry Potter en phase d’apprentissage, Jésus est déjà capable de choses
étonnantes. Mais il faudra attendre la fin du roman pour s’en rendre compte.
Car il y a d’autres urgences.
Joseph, son père menuisier, accusé de meurtre, est condamné à mort. Il a été
chargé de construire lui-même la croix sur laquelle il sera supplicié. Jésus ne
peut pas croire que Joseph ait tué Epulon. Pomponius, qui trouve le gamin
sympathique, accepterait-il de l’aider à prouver son innocence ? Et
pourquoi pas ? L’affaire roule, contre vingt deniers.
Pendant ce temps, la première
croix de Joseph a été refusée par le tribun Appius Pulcher, chargé de
l’exécution du menuisier, au prétexte qu’il n’a jamais commandé une croix en X.
En réalité, Appius n’accorde aucune importance au modèle. Mais il lorgne sur
une fructueuse affaire immobilière pour laquelle il n’a pas le premier
sou : il veut investir dans l’achat d’un terrain sur lequel se bâtira
prochainement un quartier neuf, et dont la valeur augmentera. Sa mission de
justicier devrait donc se prolonger un peu, le temps de rassembler la somme
nécessaire à fonder sa fortune à venir.
Joseph retourne au travail. Et
refuse de livrer à Pomponius le secret qui pourrait le sauver : il a eu en
effet, avant la mort d’Epulon, une discussion animée avec celui-ci. Mais
Joseph, honnête homme, a juré le secret. Un serment plus important à ses yeux
que la menace de sa prochaine crucifixion.
Honnête homme et honnête
menuisier, il fait si bien que la nouvelle croix est bientôt prête. Appius
pourra-t-il encore retarder l’exécution ? Peut-être, s’il trouve deux
autres condamnés pour obliger Joseph à fabriquer deux nouvelles croix. Grâce à
des péripéties qui sont autant de trouvailles, les trois croix ne serviront
pas. Du moins, pas tout de suite…
Eduardo Mendoza s’infiltre
dans les années les moins connues d’une histoire bien connue. Les contraintes
sont nombreuses, parce qu’il respecte la version proposée par les Evangiles.
Mais sa liberté est grande, et il en profite avec une allégresse plaisante à
partager.
Lazare, le lépreux, n’est pas
encore mort et mendie dans Nazareth en accusant Jésus et d’autres jeunes
gredins de lui lancer parfois des pierres. Marie, dont la réputation a souffert
à la naissance de son fils puisqu’il s’est beaucoup répété que Joseph n’en
était pas le père, sourit doucement et n’en pense pas moins – elle est bien la
seule, avec le lecteur, à avoir une idée de la suite. Marie-Madeleine, qui ne
s’appelle pas encore ainsi, survit à la mort de sa mère dont elle reprendra la
profession de prostituée.
Tout
le monde est là. Et tout reste à faire.Note du 30 novembre 2016. - Après le Prix Kafka, Eduardo Mendoza vient de recevoir le Prix Cervantès.
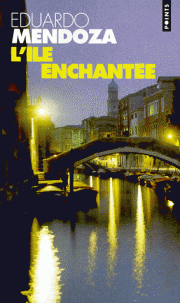







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire